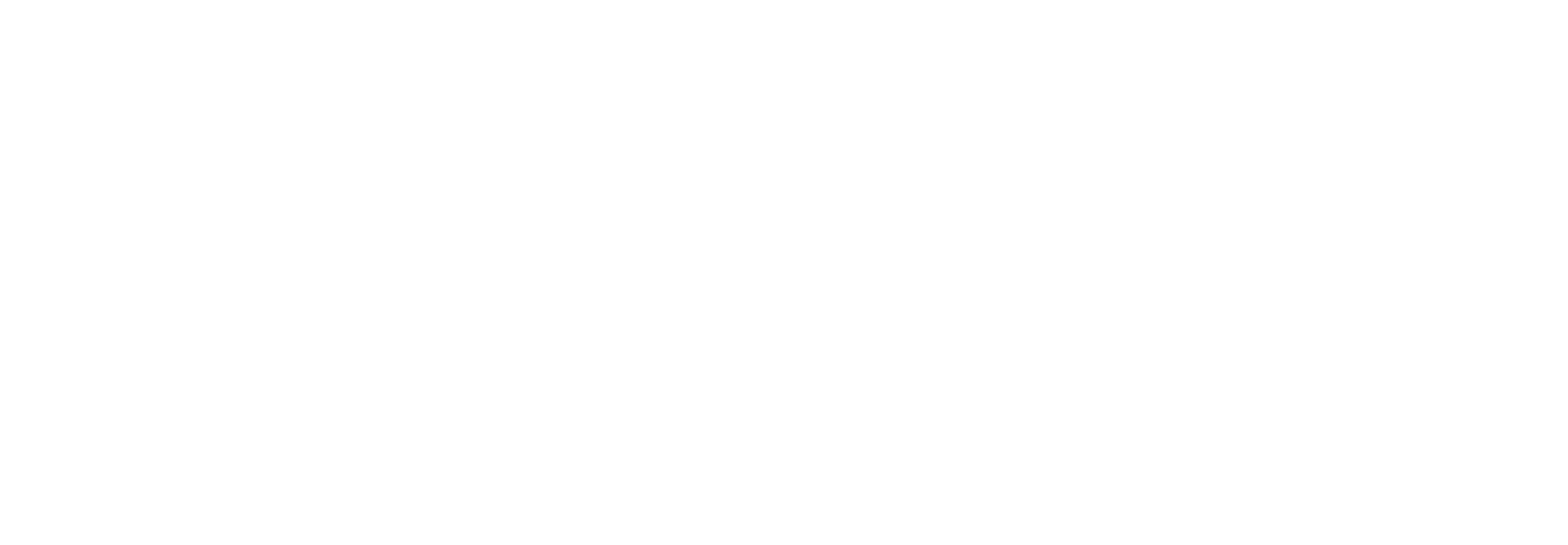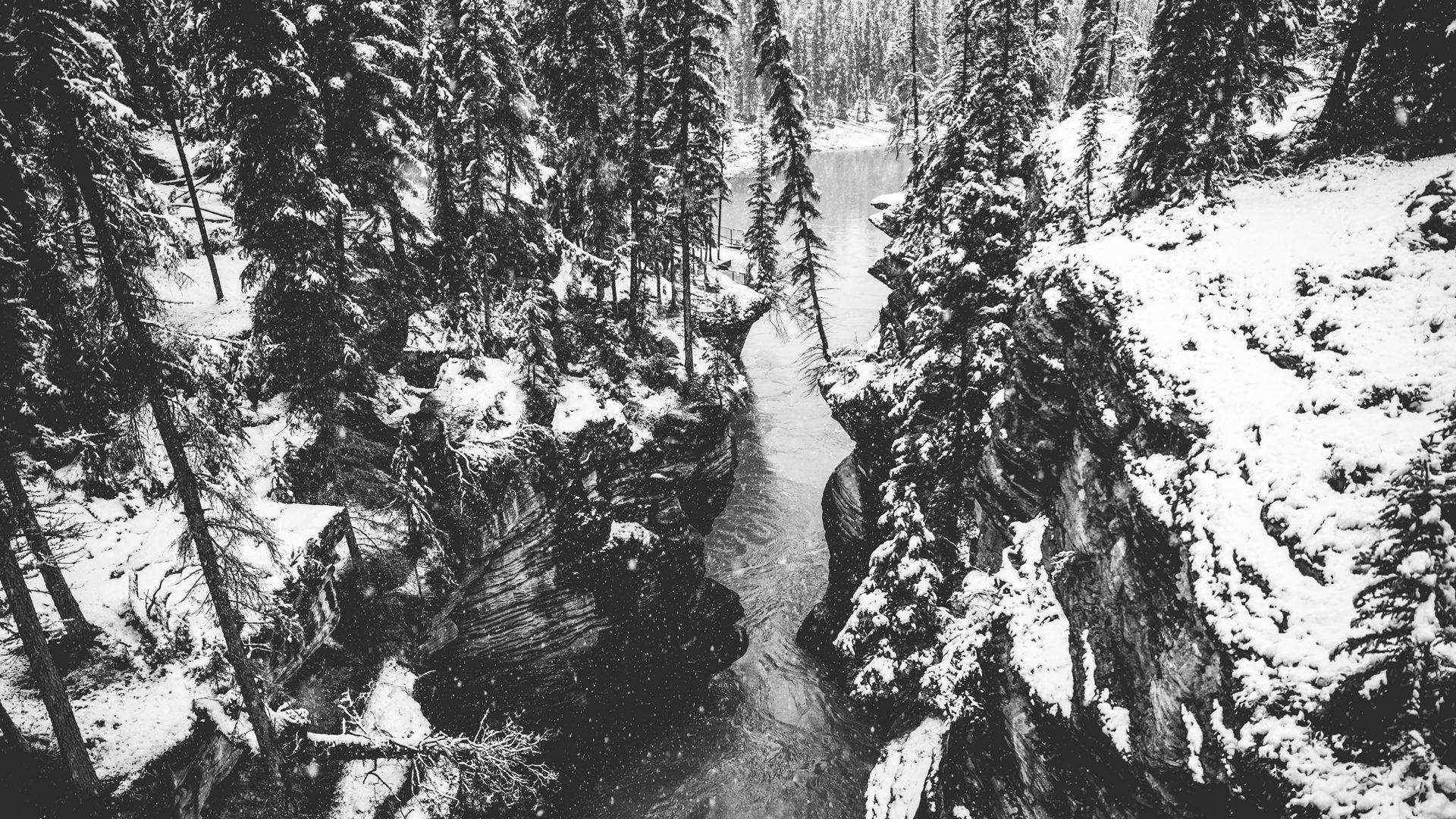« Retourner à la terre » au Québec en 2023 : un déplacement de la protestation
Article complet du #93 | Qu’est-ce qu’une vie sobre ?
FR : À partir de l’étude de cas du « retour à la terre » contemporain au Québec, cet article tente de dévoiler les espoirs, les contraintes et les contradictions d’une vie plus sobre. En s’attachant à dépeindre ses ruptures et ses continuités avec le mouvement des années 1960, il vise à répondre aux questions suivantes : comment prennent forme ces projets de vie agricole, plus sobre et plus proche de la terre ? Quels sont les espoirs, difficultés et contradictions qui caractérisent le mouvement actuel ? C’est avec une partie des représentants du « retour à la terre » d’aujourd’hui que je propose de répondre à cette question : les nouveaux agriculteurs de « première génération », non issus du milieu et ayant choisi de bifurquer vers l’agriculture. L’enquête repose sur un corpus de 61 entrevues semi-dirigées auprès de ces néo-agriculteurs québécois, aujourd’hui maraîchers, éleveurs ou acériculteurs. Les résultats montrent que, par rapport au précédent mouvement, le « retour à la terre » actuel a subi deux transformations majeures. Le projet d’émancipation du système est devenu un projet à dominante professionnelle permettant de construire et de s’épanouir au sein de sa propre entreprise. Il s’effectue dans, et non plus hors de la société : les néo-agriculteurs cherchent à s’intégrer, acceptent les aides de l’État et choisissent l’exemplarité comme forme de militantisme. Soumis à des impératifs économiques pour pérenniser l’installation, ces projets de retour, en collaborant avec le « système », sont révélateurs d’un déplacement de l’utopie anti-institutionnelle initiale.
Mots clés : retour à la terre, néo-agriculteurs, agriculture, entrepreneuriat, militantisme.
EN: Based on a case study of the contemporary « back-to-the land » in Quebec, this article attempts to reveal the hopes, constraints, and contradictions of a more sober lifestyle. By depicting the ruptures and continuities with the 1960s movement, it aims to answer the following questions: how do these projects for a more sober agricultural life, closer to the land, take shape? What are the hopes, difficulties and contradictions that characterize today’s movement? I propose to answer this question with some of the representatives of today’s « back-to-the-land »: the new « first-generation » farmers who have chosen to switch to agriculture. The survey is based on a corpus of 61 semi-structured interviews with these new farmers from Quebec, who are now market gardeners, livestock breeders or maple syrup producers. The results show that, compared with the movement of the time, today’s « back-to-the-land » has undergone two major transformations. The project of emancipating oneself from the system has become a predominantly professional one, enabling one to build and flourish within one’s own business. It takes place within, rather than outside, society: new farmers seek to integrate, accept public funds, and choose exemplarity as a form of activism. Subjected to economic imperatives to perpetuate the establishment, these projects, by collaborating with the « system », reveal a shift in the initial anti-institutional utopia.
Keywords: back-to-the-land, neo-farmers, farming, entrepreneurship, activism.