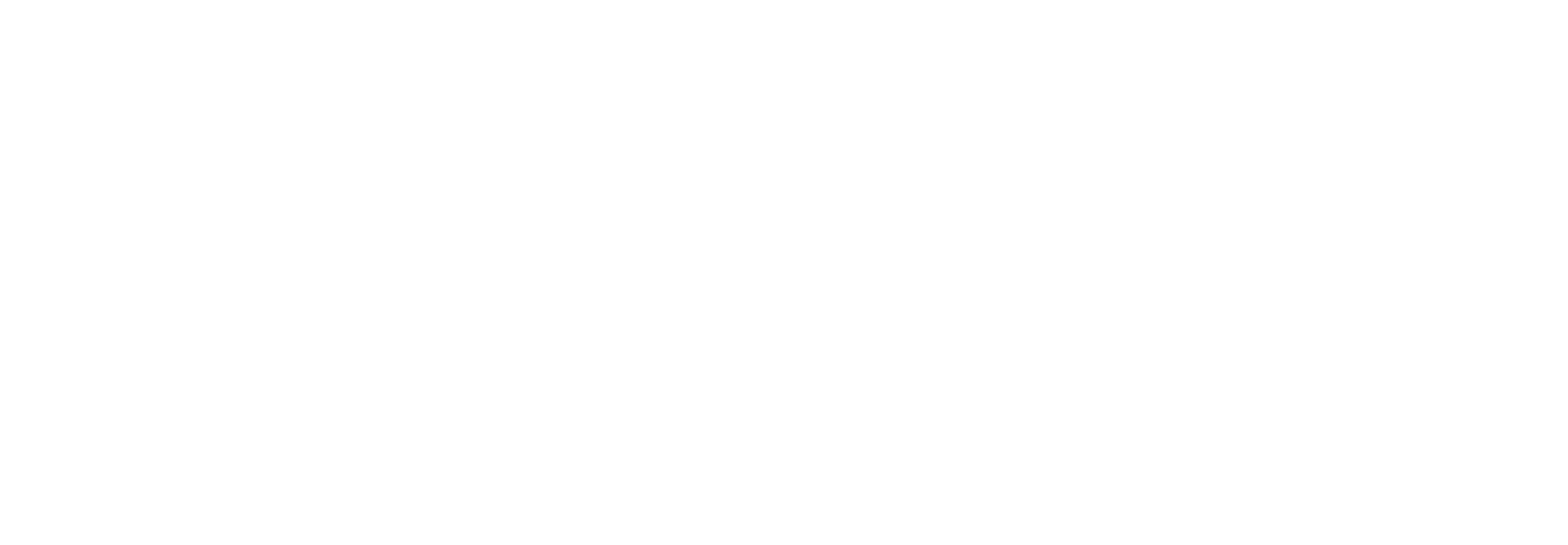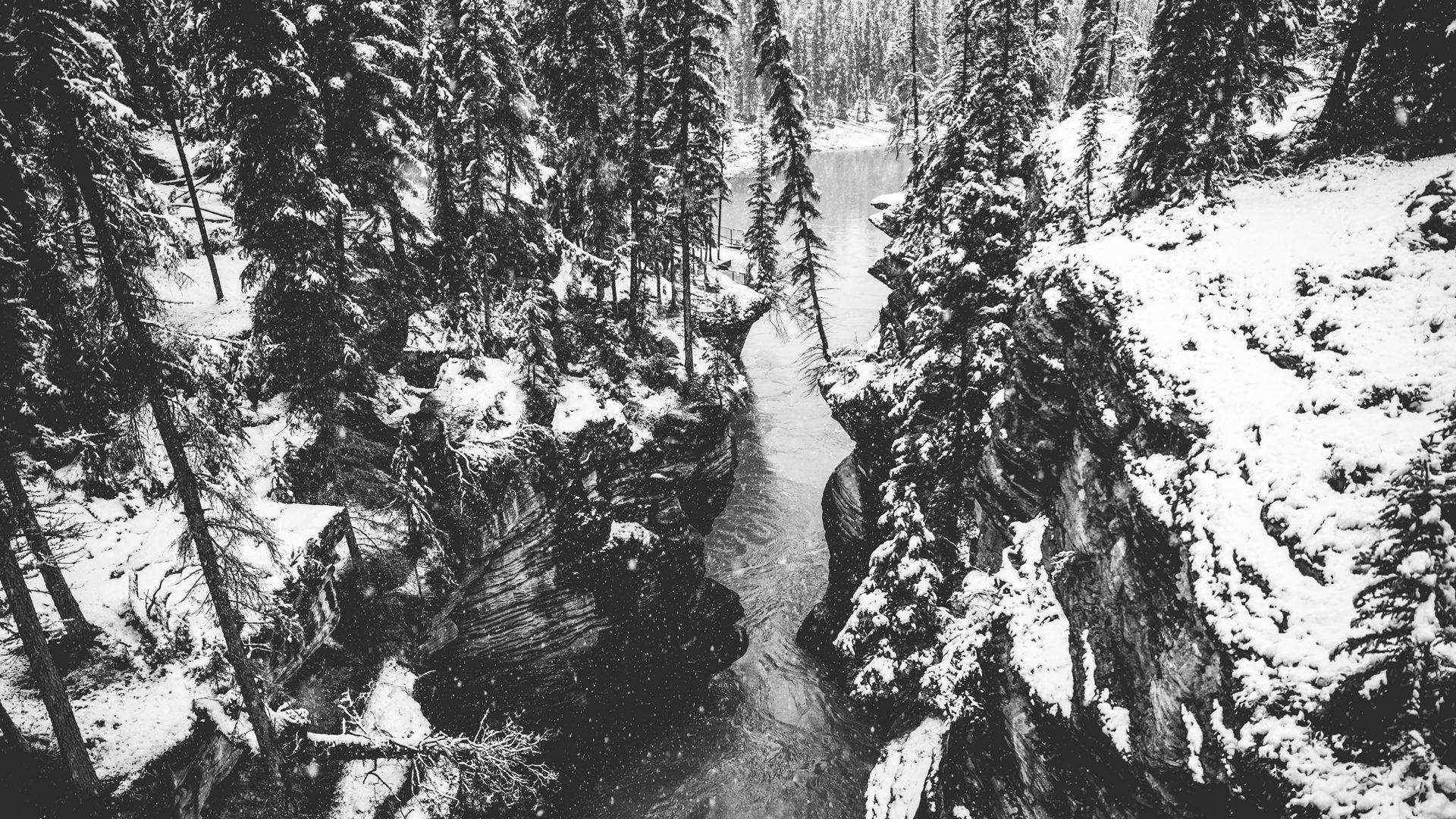Peut-il y avoir une vie sobre sans travail sobre ?
Article complet du #93 | Qu’est-ce qu’une vie sobre ?
FR : Être sobre, impératif moral, consiste à limiter durablement les empreintes des activités humaines. Les réflexions de Judith Butler (2014) sur la vie bonne permettent de soutenir qu’une vie sobre ne peut idéalement se concevoir que par la délibération entre égaux, dans une société où chaque collectivité : d’une part, prend conscience de ses propres vulnérabilités (environnementales et sociales) ; d’autre part, reconnaît sa part de responsabilité dans la production de ces vulnérabilités ; et enfin, décide d’agir, de façon solidaire, pour les réduire. Parmi les facteurs permettant d’identifier les vulnérabilités et leur inégale distribution, le travail joue un rôle clé.
Nous poserons qu’un travail peut être dit sobre s’il respecte les conditions suivantes : 1) les travailleurs participent aux décisions concernant leur production et l’organisation de leur activité ; 2) celles-ci répondent à l’intérêt général ; 3) ils prennent en compte l’impératif de limiter les empreintes de leurs activités ; 4) les évolutions du droit du travail rendent pérenne cette configuration.
Pour tester la pertinence de ce cadre d’analyse, nous mobilisons les résultats d’une étude empirique portant sur des travailleurs « engagés » du numérique : a) les premiers ont mis en oeuvre des projets/organisations de plateformes coopératives numériques ; b) les seconds, salariés d’une multinationale, essayent, dans leurs pratiques quotidiennes, de mener des activités sobres. Si le travail dans les coopératives numériques correspond à notre définition, il n’en va pas de même au sein de la multinationale, l’impératif de sobriété entrant en tension avec celui de la création de valeur pour l’actionnaire.
Mots clés : Travail sobre, Coopératives numériques, Vulnérabilité, Vie bonne, Empreintes environnementales, Empreintes sociales
EN: Being sober, a moral imperative, involves sustainably limiting the footprints of human activities. Judith Butler’s (2014) reflections on the good life suggest that a sober life can ideally only be conceived through deliberation between equals, in a society where each community: firstly, becomes aware of its own vulnerabilities (environmental and social); secondly, recognises its share of responsibility in the production of these vulnerabilities; and finally, decides to act in solidarity to reduce them. Among the factors that make it possible to identify vulnerabilities and their unequal distribution, work plays a key role.
We will assume that work can be said to be sober if it meets the following conditions: 1) workers participate in decisions concerning their production and the organisation of their activity; 2) these decisions are in the general interest; 3) they consider the need to limit the impact of their activities; 4) changes in labour law make this configuration sustainable.
To test the relevance of this analytical framework, we use the results of an empirical study of “committed” digital workers: a) the former have implemented projects/organisations of digital cooperative platforms; b) the latter, employees of a multinational corporation, try, in their daily practices, to carry out sober activities. While work in digital cooperatives corresponds to our definition, the same cannot be said of work in multinationals, where the need for sobriety is in tension with the need to create shareholder value.
Keywords: Sober work, Cooperatives, Digital, Vulnerability, Good life, Environmental footprint, Social footprint