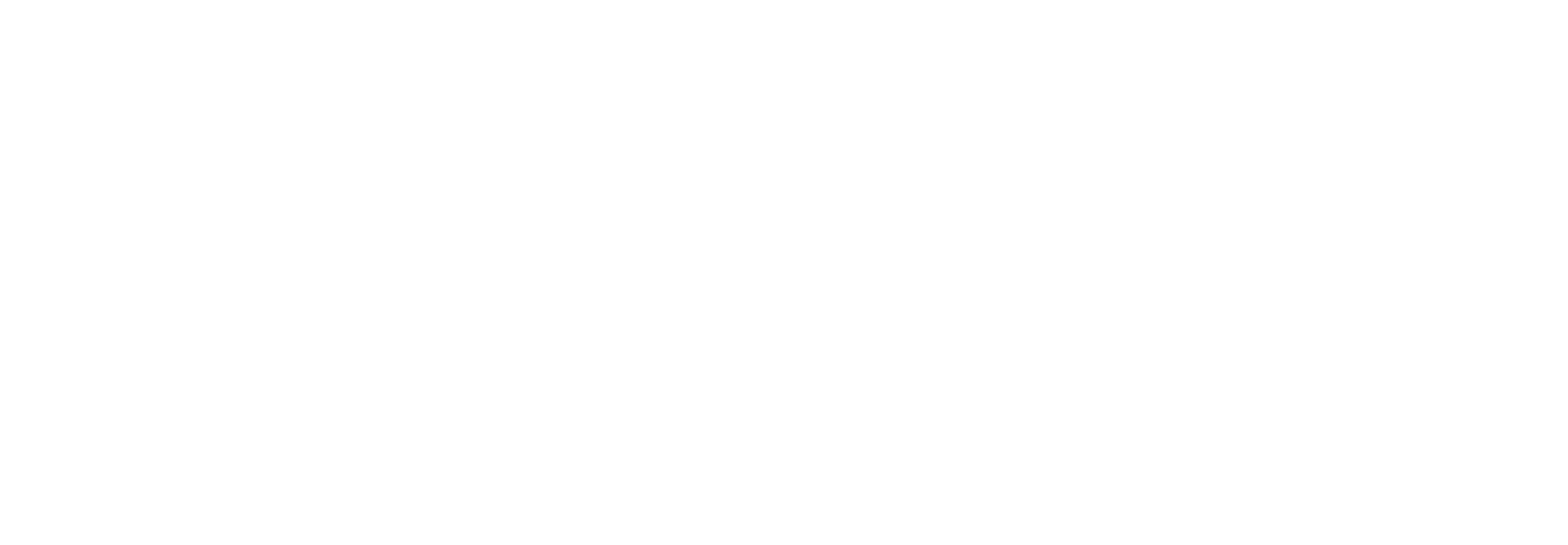Le « paradoxe Walden » : la vie sobre est-elle anti-économique ?
Article complet du #93 | Qu’est-ce qu’une vie sobre ?
FR : Cet article se propose d’aborder la vie sobre à partir de l’ouvrage Walden (1854) de Henry David Thoreau, tiré de son expérience de vie au milieu de la nature, dans une cabane autoconstruite près du lac Walden durant un peu plus de deux ans. Ce récit d’une vie consacrée quasiment entièrement au loisir (marche, natation, lectures, écriture…) grâce à une stricte limitation de ses besoins conduit au « paradoxe Walden ». En effet, d’un côté Thoreau en homme des bois apparaît comme le parfait homo oeconomicus qui évalue sa satisfaction et arbitre minutieusement l’usage de son temps pour en tirer le meilleur parti. D’un autre côté, pour pouvoir vivre selon ses préférences, il doit s’éloigner de la société et s’opposer aux principes qui orientent la vie de ses concitoyens et représentent le confort et le progrès. Un détour par les penseurs de l’avènement du capitalisme permet de résoudre ce paradoxe d’une vie sobre en opposition à l’ordre économique et social dominant, et pourtant conforme à une définition formelle de l’économie. En effet, la représentation d’un agent économique libre et rationnel ne correspond pas à la réalité historique du capitalisme, qui ne s’appuie pas, comme l’a montré Max Weber, sur le libre arbitre et la pluralité des modes de vie qu’il prétend défendre mais sur la valorisation de la richesse et de l’engagement dans le travail qui conditionne subjectivement ces modes de vie. L’esprit du capitalisme ne s’appuie pas non plus sur une conception plurielle de l’intérêt, mais s’identifie progressivement, comme l’a montré Albert O. Hirschman, à une conception réduite à l’accumulation de richesses. Ainsi la vie sobre constitue-t-elle une brèche dans un ordre économique et social en contestant en pratique une forme de vie dominante et les principes qui en sont le fondement.
Mots clés : Sobriété – Simplicité volontaire – Homo œconomicus – Henry David Thoreau – Théorie critique – Esprit du capitalisme
EN: This article focuses on sufficiency from the point of view of Henry David Thoreau’s Walden (1854), based on his experience of living in the middle of nature, in a self-built cabin at Walden Pond, for just over two years. This narrative of a life devoted almost entirely to leisure (walking, swimming, reading, writing…) thanks to a strict limitation of his needs leads to the “Walden paradox”. Indeed, on the one hand, Thoreau, as a man of the woods, appears as the perfect economic man who evaluates his satisfaction and achieves an economic trade-off between uses of time to make the most of it. On the other hand, in order to live as he prefers, he must distance himself from society and be opposed to his fellow citizens’ life principles that represent comfort and progress. A detour via the thinkers of the advent of capitalism leads us to solve the paradox of a sober lifestyle opposed to the dominant economic and social order, and yet conform to a formal meaning of economics. Indeed, the representation of a free and rational economic agent doesn’t correspond to the historical reality of capitalism that Max Weber showed not to be based on free will or the pluralist lifestyles it claims to defend, but rather on work ethic and on the valorization of wealth, which characterize a capitalist subjectivity. The spirit of capitalism isn’t either based on a pluralist conception of interest − instead, as Albert O. Hirschman showed, it has gradually been identified with a conception reduced to wealth’s accumulation. Sufficiency thus constitutes a break through economic and social order, criticizing in practice a dominant form of life and its founding principles.
Keywords : Sufficiency – Voluntary Simplicity – Economic Man – Henry David Thoreau – Criticism – Spirit of Capitalism