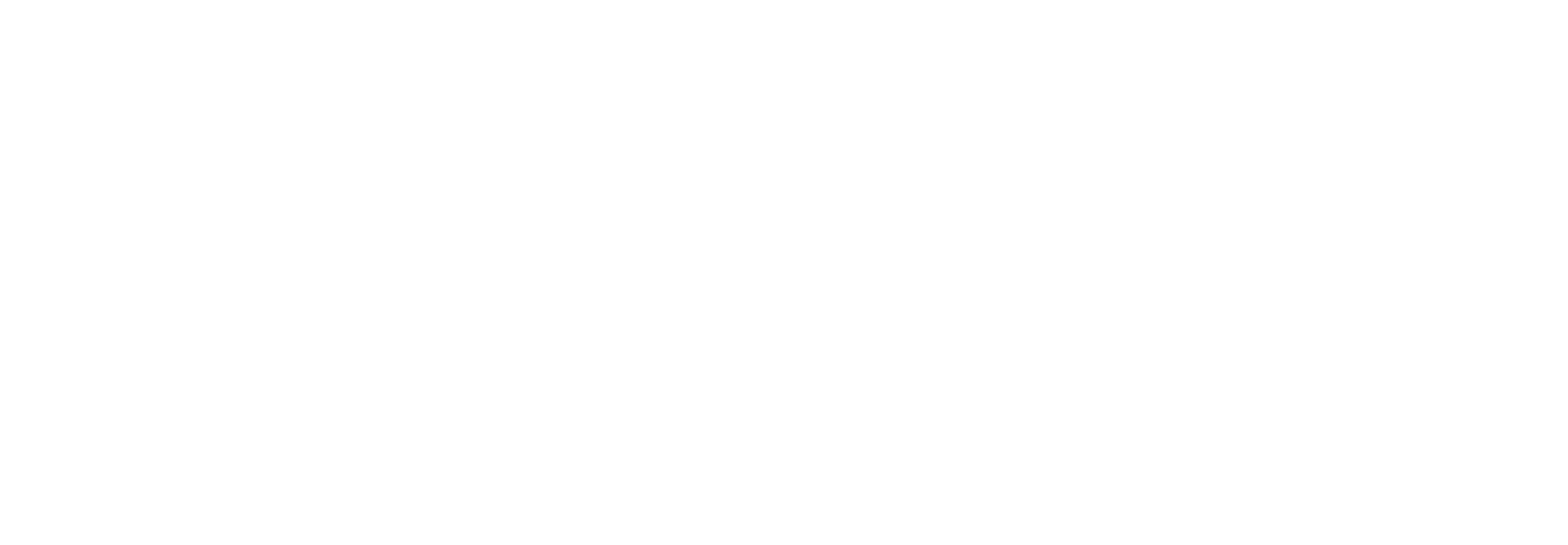#94 | L’aide au prisme des âges de la vie
Sommaire
Introduction
L’aide au prisme des âges de la vie
Isabelle Mallon et Isabelle Marchand
Section 1 – Les fabriques précoces et différenciées des dispositions
Jouer à aider : l’intériorisation des dispositions genrées à aider pendant l’enfance
Juliette Grisoni
|
FR : La perception des enfants comme des individus uniquement receveur∙ses de soin a conduit les enquêtes sociologiques à mettre de côté l’analyse de leurs comportements d’aidant∙es. L’apprentissage de l’entraide est pourtant l’un des objectifs de l’école maternelle, qui présuppose alors une socialisation à l’aide dès la petite enfance. À partir d’observations ethnographiques réalisées dans une école maternelle parisienne, cet article s’attache à décrire les mécanismes de socialisation par lesquels les filles intériorisent des dispositions à aider dans le cadre scolaire. Plus particulièrement, il s’agit d’analyser les pratiques ludiques genrées des enfants comme des vecteurs de socialisation à l’aide par l’incarnation des rôles d’« aidés » pour les garçons et d’« aidantes » pour les filles. Les modalités spécifiques des jeux d’imitation pratiqués par les filles conduisent ces dernières à adopter des pratiques d’aide inspirées des figures de la « maman » et de la « maîtresse », qu’elles transposent progressivement au cadre du non-jeu. Ce type de comportements est alors valorisé par les adultes de l’école, incitant les filles à les reproduire quotidiennement dans leurs relations aux autres.
Mots clés : socialisation genrée, dispositions à aider, jeux d’imitation, école maternelle
EN: The perception of children only as care receivers has led sociological surveys to put aside the analysis of their helping behaviours. However, learning to help is one of the objectives of preschools, which then presupposes a socialisation to helping practices from early childhood. Based on ethnographic observations carried out in a Parisian preschool, this article aims to describe the mechanisms of socialisation by which girls internalize dispositions to help in school environment. More particularly, it analyses the gendered playful practices of children as vectors of socialisation to helping behaviours, through the incarnation of the roles of “cared-for” for boys and “carers” for girls. The specific modalities of pretend plays performed by girls lead them to adopt helping practices inspired by the figures of the “mother” and the “teacher”, which they gradually transpose to a non-play frame. This type of behaviour is then valued by adults at the school, encouraging girls to reproduce it in their daily relationships with others.
Keywords: gender socialisation, dispositions to help, pretend plays, preschools
Aider un·e proche au temps des jeunesses, entre norme d’insouciance et devoir de solidarité familiale
Hélène Buisson-Fenet et Diane Béduchaud
|
FR : La plupart des travaux portant sur les arrangements autour de l’aide intrafamiliale ont concerné les adultes à l’égard de leurs parents, en particulier en contexte de dépendance du grand âge. Toutefois, certains se sont penchés sur une aide plus méconnue, celle fournie par de jeunes aidant·es qui inversent la norme d’âge des solidarités privées. Issu d’une recherche doctorale en cours, cet article vise à examiner les spécificités de l’aide apportée aux barreaux les plus bas de l’échelle des âges, tout en mettant en évidence les logiques sociales des variations de cette aide. Que signifie « aider » un proche malade ou en situation de handicap au jeune âge, selon qu’on est enfant ou jeune adulte ? Nous aborderons d’emblée la diversité interne de la catégorie des « jeunes aidants », dont l’hétérogénéité des expériences confirme le caractère d’artefact. Nous montrerons ensuite qu’à l’âge des premières fois, les primes socialisations aux relations d’aide engagent une économie morale domestique reposant sur quelques principes invariants (comme la délimitation parentale de « l’aide abusive »), mais que tous les ménages ne définissent pas uniment « l’aide acceptable », et l’aide à un·e ascendant·e s’annonce le plus souvent plus exigeante que celle à un·e adelphe. Progressivement, les jeunes acquièrent des nouvelles responsabilités, dont certaines sont directement liées au passage de certains seuils d’âge, rendant possibles de nouvelles pratiques (conduite, emploi rémunéré). En outre, le travail d’aide intègre des activités hétérogènes de mise en relation avec l’extérieur du foyer, alourdissant la responsabilité légale du·de la jeune mais permettant aussi de décloisonner la prise en charge.
Mots clés : jeune aidant·e, aidant·e, proche aidant·e, aide familiale, travail domestique, travail émotionnel, jeunesse, enfance
EN: Most work dealing with arrangements around intrafamilial care has focused on adults providing care for their parents, particularly in the context of elderly dependency. However, some have focused on a lesser-known form of care, one provided by young carers who invert the age norm of private solidarities. This article, which stems from ongoing doctoral research, aims to examine the specific characteristics of the care provided at the lowest rungs of the age ladder, while highlighting the social logics of these variations. What does it mean to « care » for a sick or disabled relative at an early age, whether you are a child or a young adult ? We will start by looking at the internal diversity of the category of « young carers », whose heterogeneity of experiences provides a good account of the artefact. We will then show that, at the age of first-times, early socialization into caring relationships engages a household ethical code based on a few invariant principles (such as parental delimitation of « abusive care »), but that not all households uniformly define « acceptable care », and caring for an ascendant more often turns out to be more demanding than caring for a sibling. As they grow older, young people acquire new responsibilities, some of which are directly linked to the crossing of certain threshold ages, making new practices possible (driving, paid employment). In addition, the work they do as carers integrates a variety of activities involving contact with people outside the home, increasing the young person’s legal responsibilities but also enabling them to take a more decentralized approach to care.
Keywords: young carer, carer, family carer, domestic work, emotional work, youth, childhood
Se faire aider, ou pas, par son enfant : moralités ordinaires et sens pratique des parents aveugles
Marion Doé
|
FR : L’aide des enfants à un parent handicapé n’a pas fait l’objet d’un grand nombre de travaux au sein des études sur le handicap. Les enfants sont envisagés par celles-ci davantage comme des êtres jeunes et immatures, censés être protégés, contrairement aux aidants adultes de parents âgés auxquels s’intéresse la sociologie du vieillissement. L’article se base sur une recherche dédiée aux expériences de parentalité de personnes aveugles qui, afin d’assurer les différentes tâches de care parental, fournissent un travail (émotionnel, corporel, temporel et relationnel) pour accéder à une forme d’autonomie. La recherche met notamment en évidence les tensions entre le statut de parent, en tant que pourvoyeur de soin, et celui de personne handicapée, donc dépendante, et l’aide des enfants en est une illustration saillante. L’article s’intéresse aux manières dont les parents aveugles vivent leur dépendance au quotidien – car il ne s’agit pas de la nier – vis-à-vis de leurs enfants valides, capables en principe de les aider, et comment ils se positionnent face à cette asymétrie fonctionnelle inversée par rapport à l’asymétrie générationnelle et d’âge. La méthodologie mobilise des entretiens qualitatifs effectués avec 33 parents aveugles, des discours en ligne sur des groupes fermés, dédiés à la parentalité aveugle, des observations de huit mois dans un service d’accompagnement à la parentalité pour les personnes handicapées, et enfin ma propre expérience de mère concernée par la cécité.
Mots clés : parentalité, handicap, aide des enfants, moralité ordinaire
EN: Children’s support for a disabled parent has not been extensively explored within disability studies. Children are typically viewed as young and immature beings in need of protection, in contrast to the sociology of ageing which focuses on adult caregivers of elderly parents. The article is based on research into the parenting experiences of blind people who, in order to fulfil various parental caregiving tasks, engage in emotional, physical, temporal, and relational work to attain autonomy. The article notably highlights the tensions between the status of parent, as caregiver, and that of the disabled person, as dependant, with the help of children serving as a prominent illustration. The article examines how blind parents experience their day-to-day dependence – acknowledging its existence – on their able-bodied children, who are in principle capable of helping them, and how they navigate this functional asymmetry, which is reversed in relation to the generational and age asymmetry. The methodology involved qualitative interviews with 33 blind parents, online discussions in closed groups dedicated to blind parenting, eight months’ observations in a parenting support service for disabled people, and finally, my own experience as a blind mother.
Keywords: parenting, disability, children’s help, day-to-day common sense /ordinary moralities
Section 2 – Parcours de vie, transitions et pratiques d’entraide
Prendre soin de notre monde : évolution de la participation civique au cours de la vie
Stéphanie Gaudet
|
FR : La participation civique est un élément crucial du tissu social, du contrat démocratique et de notre capacité collective à prendre soin de notre monde. Cet article présente, à partir de données qualitatives, l’évolution de la participation civique selon les différentes transitions de vie des individus, passant des modes formels aux plus informels, des pratiques visibles aux invisibles, ou encore des pratiques audibles, visant à défendre une voix ou une vision du monde, aux pratiques inaudibles. Les entretiens mettent en lumière les récits de pratiques d’adultes âgés de 25 à 55 ans, un groupe d’âge peu visible dans les analyses de parcours de vie. À partir des théories du care, nous proposons une typologie des pratiques participatives et montrons comment les transitions et les événements de vie propres à la sphère privée façonnent et influencent profondément les engagements civiques au sein de la sphère publique. Cet article offre un éclairage novateur sur l’évolution des pratiques civiques à travers les parcours de vie, mettant de l’avant l’impact significatif de la parentalité, tout en soulignant l’interconnexion entre l’éthique du soin et la diversité des pratiques de participation civique.
Mots clés : participation civique, parcours de vie, adulte, genre, démocratie.
EN: Civic participation is a crucial part of the social fabric, of the democratic contract and of our collective ability to care for our world. Using qualitative data, this article looks at how civic participation evolves with the different transitions in people’s lives, moving from formal to more informal modes, from visible to invisible practices, and from audible practices, aimed at defending a voice or a vision of the world, to inaudible practices. The interviews highlight the accounts of the practices of adults aged between 25 and 55, an age group rarely included in life-course research. Drawing on care theories, we propose a typology of participatory practices and show how transitions and life events in the private sphere profoundly shape and influence civic engagement in the public sphere. This article sheds new light on the evolution of civic practices across the life course, highlighting the significant impact of parenthood while underlining the interconnection between the ethic of care and the diversity of civic participation practices.
Keywords: civic participation, life course, adulthood, gender, democracy
Parcours de vieillissement des aîné·es migrant·es : des réseaux d’aide et d’entraide évolutifs et diversifiés
Marie-Emmanuelle Laquerre, Marianne Théberge-Guyon et Amina Mezdour
|
FR : Le vieillissement de la population migrante est un enjeu grandissant au Québec, plus particulièrement à Montréal, où 44 % des personnes âgées de 65 ans et plus sont né·es à l’extérieur du pays. Les recherches montrent que les aîné·es migrant·es sont particulièrement à risque de vivre de l’exclusion sociale en raison de l’existence de barrières culturelles et structurelles reliées à leur contexte migratoire. Plusieurs personnes âgées migrantes disent toutefois bénéficier d’un vieillissement satisfaisant qui semble fortement relié aux formes d’aide reçues et données. À partir d’une étude portant sur le vécu expérientiel des aîné·es migrant·es, cet article met en lumière la spécificité de ces formes d’aide en contexte migratoire tout en soulevant la structuration évolutive des réseaux d’entraide au fil de l’avancée en âge. Des entretiens individuels menés auprès d’aîné·es migrant·es vivant dans la région métropolitaine de Montréal ont permis de faire ressortir les manières plurielles dont ces personnes se situent exclusivement, successivement ou simultanément en position d’aidé·e ou d’aidant·e au sein de leurs réseaux familiaux, amicaux et communautaires. Les résultats mettent en évidence le vécu émotionnel et la dimension affective associés à ces diverses configurations de solidarités, qu’elles soient ou non désirées autrement. La collecte de données s’étant déroulée avant et pendant la pandémie de covid-19, les résultats présentés témoignent des nouvelles formes de soutien qu’elle a fait naître comme de l’effritement de certaines relations d’aide dont bénéficiaient ou auxquelles prenaient part les aîné·es migrant·es vivant au Québec.
Mots clés : Trajectoires, vieillissement, personnes âgées, migrant, pratiques d’aide, pratiques d’entraide
EN: Aging of the immigrant population is a growing concern in Quebec, particularly in Montreal, where nearly half of seniors (44%) were born outside of Canada. Research indicates that immigrant elders are particularly at risk of social exclusion due to several barriers related to their migration context, among which we find language difficulties and lack of service knowledge. However, many immigrant elders take a positive view regarding their aging journey mainly because of support practices and mutual care provided to them or by them. Based on a study regarding immigrant seniors’ experiences, this article sheds light on the specific features of received and provided support and mutual care in a migratory context, while highlighting the evolving network support seen with advancing age. Individual interviews conducted with immigrant elders of the Montreal metropolitan area have highlighted the plurality of ways in which these seniors are exclusively, successively, or simultaneously the ones providing care or receiving care within their family, friends, and community network. Our results put forward the emotional experience and affective dimension linked to these multiple solidarity configurations that could be wanted or not by immigrant elders of our study. As the data was collected before and during the Covid-19 pandemic, the results presented here illustrate the new forms of support it gave rise to, as well as the erosion of certain support relationships from which migrant seniors living in Quebec benefited or in which they were involved.
Keywords: Trajectories, aging, elderly, immigrants, support practices, mutual care
Trajectoire et vécu des aidantes et aidants lors de la crise sanitaire de la covid-19 en France
Christèle Meilland, Virginia Mellado et Arnaud Trenta
|
FR : En France, la crise sanitaire du Covid-19 et le confinement généralisé de la population ont exercé une forte tension sur l’activité d’aide des proches de personnes âgées en perte d’autonomie et de personnes en situation de handicap. Les restrictions de déplacement et la fermeture de nombreux services sanitaires et médico-sociaux ont renforcé l’isolement des aidantes et des aidants qui accompagnent leur proche à domicile. Entre mars et mai 2020, une enquête par questionnaire a été menée en ligne auprès des adhérents des associations membres du Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux (1032 réponses). L’article analyse les différents vécus de l’aide pendant le confinement en comparant les situations selon le genre de l’aidant et le lien avec la personne aidée. Il interroge également la relation entre la trajectoire d’aide et le vécu d’une crise aussi aigüe que la pandémie de Covid-19.
Mots clés : Autonomie ; Aide à domicile ; Aidants familiaux ; Trajectoire ; Handicap ; Vieillissement ; Covid-19 ; France
EN: In France, the Covid-19 health crisis and the general confinement of the population have put a great deal of pressure on the caring activities of relatives of elderly and people with disabilities. Travel restrictions and the closure of many health and medical-social services have increased the isolation of family carers who support their loved ones at home. Between March and May 2020, a questionnaire survey was carried out online among members of the associations belonging to the Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux (1032 responses). The article analyses the different experiences of caring during confinement, comparing situations according to the gender of the caregiver and the relationship with the recipient. It also examines the relation between caregiving trajectory and the experience of a crisis as acute as the Covid-19 pandemic.
Keywords: Long Term Care; Homecare; Family Caregivers; Trajectory; Disability; Aging; Covid-19; France
La population âgée et les aides aux usages du numérique : une analyse en termes de capital numérique et de réseaux d’aide
Vincent Caradec, Ségolène Petite, Aline Chamahian et Sophie Colas
|
FR : Cet article étudie la diversité des formes d’aide aux usages du numérique dans lesquelles sont impliquées les personnes âgées. Fondé sur l’analyse d’un corpus de 40 entretiens semi-directifs réalisés en France métropolitaine avec des personnes appartenant à trois générations (1935-1939, 1945-1949 et 1955-1959) et aux profils sociodémographiques variés, il suit un double fil analytique. D’une part, il prend en compte la plus ou moins grande familiarité avec le numérique des personnes enquêtées, en l’appréhendant à partir du concept de capital numérique. D’autre part, il s’intéresse aux modalités concrètes des aides et à leur inscription relationnelle de façon à établir une cartographie des aidants et à dégager les logiques sous-jacentes à l’organisation des relations d’aide. Dans un premier temps, il établit que les aides au numérique prennent des formes différentes selon le niveau du capital numérique : la délégation lorsque le capital numérique est inexistant ou inexploité ; la recherche de soutien et l’apprentissage lorsqu’il est à consolider ; une posture de possible donneur d’aides lorsqu’il est plus élevé. Dans un deuxième temps, il souligne l’importance de l’aide familiale, et notamment celle des enfants, en matière numérique. Plus fondamentalement, il montre que ce sont les caractéristiques et la dynamique des relations familiales qui éclairent l’organisation de l’aide et expliquent, dans certains cas, le recours à des aidants non familiaux et à des professionnels rémunérés.
Mots clés : aide ; aidants ; numérique ; personnes âgées ; vieillissement
EN: This article examines the diversity of forms of help with digital uses in which the elderly are involved. Based on the analysis of a corpus of 40 semi-directive interviews conducted in France with people belonging to three generations (1935-1939, 1945-1949 and 1955-1959) and with varied socio-demographic profiles, it follows a double analytical thread. On the one hand, it takes into account the degree of familiarity with digital technology of the people surveyed, based on the concept of digital capital. On the other hand, it looks at the concrete ways in which help is provided and how it is embedded in relationships, so as to map out the caregivers and identify the underlying logic behind the organization of help relationships. Firstly, it establishes that digital assistance takes different forms depending on the level of digital capital: delegation when digital capital is non-existent or unexploited; support seeking and learning when it needs to be consolidated; a posture of possible provider of assistance when it is higher. Secondly, it highlights the importance of family support, particularly from children, in digital matters. More fundamentally, it shows that it is the characteristics and dynamics of family relationships that inform the organization of help and explain, in some cases, the use of non-family carers and paid professionals.
Keywords: help; carers; digital; older adults; ageing; aging
Section 3 – Institutions, territoires et politiques
La structuration de l’aide par les positions d’âge dans les politiques départementales de l’autonomie : une remise en cause hésitante
Maëlle Moalic-Minnaert
|
FR : En France, les politiques du handicap et les politiques du grand âge constituaient depuis les années 1990 deux champs distincts de l’action publique. En dépit de la création en 2020 de la cinquième branche de la Sécurité sociale, le questionnement de la barrière d’âge au niveau national apparaît largement inachevé. Les politiques de vieillesse ayant fait l’objet, comme les politiques du handicap, d’un processus de décentralisation, il importe de resserrer la focale sur la mise en oeuvre à l’échelon départemental d’un service public de l’autonomie unique. Cet article explore l’hypothèse de la constitution par les conseils départementaux d’une nouvelle « catégorie d’action publique » en lieu et place des « personnes âgées dépendantes » et « personnes handicapées ». Afin d’éclairer ce questionnement, une analyse documentaire a été menée. Les organigrammes des conseils départementaux français ont été examinés, tout comme les outils de planification − les schémas autonomie. En complément, une campagne d’entretiens semi-directifs a été initiée auprès des cadres de l’un des conseils départementaux. Bien qu’inaboutie, la convergence, à l’échelon départemental, des politiques du handicap et des politiques du grand âge se donne à voir dans la réorganisation des services, dans les choix d’instruments, à travers le travail cognitif d’identification d’enjeux communs et dans la mise en place de dispositifs communs. La compréhension de chacune des strates de cette convergence nécessite son insertion dans une pluralité de dynamiques à l’oeuvre en matière de transformation de l’action publique. La dynamique de rapprochement est en outre différenciée d’un département à l’autre.
Mots clés : politiques de l’autonomie, politiques départementales, barrière d’âge
EN: In France, disability policies and policies for the elderly have been two distinct fields of public action since the 1990s. Despite the creation of the fifth branch of Social Security in 2020, questioning the age barrier at the national level appears largely incomplete. Both elderly and disability policies have undergone a process of decentralization, thus it is important to focus on the implementation at the departmental level of a single public service for autonomy. This article explores the hypothesis of the establishment by departmental councils of a new « category of public action » in place of « dependent elderly » and « disabled persons. » To shed light on this issue, a documentary analysis was conducted. The organizational charts of French departmental councils were examined, as well as planning tools − autonomy schemes. In addition, a campaign of semi-structured interviews was initiated with executives from one of the departmental councils. Although incomplete, the convergence, at the departmental level, of disability policies and policies for the elderly can be seen in service reorganizations, choice of instruments, through cognitive work of identifying common issues, and in the establishment of common mechanisms. Understanding each layer of this convergence requires its integration into a plurality of dynamics at work in the transformation of public action. Furthermore, the convergence dynamic varies from one department to another.
Keywords: policies of autonomy, departmental policies, age structuring
« Et si je ne pouvais plus rester seule chez moi ? » : quelles sont les attentes des personnes âgées et de leurs proches concernant les aides et l’accompagnement de la perte d’autonomie ?
Anaïs Cheneau, Jonathan Sicsic et Thomas Rapp
|
FR : En France, les politiques de l’autonomie vont devoir répondre à une hausse considérable des besoins d’accompagnement de la perte d’autonomie, dans un contexte où l’offre professionnelle de soins est en tension et où le nombre de proches aidants potentiels est amené à diminuer dans le futur. Dans ce contexte, le « virage domiciliaire » a été plaidé récemment, et vise à favoriser le vieillissement à domicile. L’objectif de l’article est d’analyser dans quelle mesure le virage domiciliaire répond aux attentes et préférences des personnes âgées et de leurs proches. Pour analyser les préférences des personnes âgées et des aidants, nous recourons à la méthode d’analyse de contenu, qui permet une analyse inductive des 36 entretiens conduits, à partir d’arbres thématiques. L’analyse de la disposition à se faire aider pour les personnes âgées et de la disposition à aider pour les aidants conduit à questionner la politique du maintien à domicile, dans laquelle on observe un écart entre les attentes respectives des familles et de l’État. Les entretiens montrent que le maintien à domicile repose en grande partie sur l’aide des proches (les enfants et conjoints), qui réalisent la quasi-totalité de l’aide administrative, de la coordination des professionnels, de la surveillance et du soutien à la vie sociale. Une partie de cette aide est « subie », faute d’une prise en charge professionnelle, ce qui peut conduire à des répercussions négatives de l’aide sur l’aidant et à des ruptures de l’aide. Pourtant, les personnes âgées sont unanimes quant à leur volonté de ne pas « trop peser » sur leurs proches, notamment leurs enfants, en cas de perte d’autonomie. Les entretiens mettent également en évidence les représentations négatives des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) par les personnes âgées et leurs proches, alors même que dans certaines situations (notamment d’isolement ou de forte dépendance avec des troubles cognitifs), l’EHPAD semble plus adapté et bénéfique que le domicile. Aujourd’hui, les ressources financières et familiales déterminent fortement la qualité de l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Mots clés : Dépendance, proches aidants, soins de long terme, EHPAD, maintien à domicile, virage domiciliaire, préférences, méthode d’analyse de contenu thématique
EN : In France, there is a growing need to support older people who are losing their independence due to the aging population. The supply of professional care is under pressure, and the number of potential family caregivers is set to decline. To promote aging at home, the « home shift » has been advocated recently. This article analyzes how the home shift meets the expectations and preferences of older people and their families. To analyze the preferences of older people and their carers, 36 interviews were conducted using the content analysis method. The interviews revealed that home care relies heavily on the care of relatives, who provide almost all the administrative assistance, coordination of professionals, supervision, and support for social life. However, some of this care is « taken over » because it is not provided by professionals, which can have a negative impact on the caregiver and lead to breaks in the care provided. The interviews also showed that older people are unanimous in their desire not to be a burden on their loved ones, especially their children, if they lose their independence. Furthermore, the negative perceptions that older adults and their families have of nursing homes were highlighted, even though in certain situations, nursing homes may be more appropriate and beneficial than living at home, such as isolation or high dependency with cognitive problems. Today, financial and family resources significantly impact the quality of support for people losing their independence. The analysis of older people’s willingness to seek care and caregivers’ desire to help leads us to question home care policy, where there is a discrepancy between the respective expectations of families and the state.
Keywords: Dependency, family carers, long-term care, nursing home, home care, preferences, thematic content analysis method
Dans l’angle mort de l’(entr)aide aux personnes âgées dans les territoires de montagne en Suisse : le « bénévolat gris » des femmes
Pauline Mesnard, Clothilde Palazzo-Crettol et Lorry Bruttin
|
FR : Cet article étudie les pratiques et représentations de l’(entr)aide locale du point de vue des femmes engagées dans des activités de care auprès des personnes âgées dans le contexte des villages alpins en Suisse. Au nom de quelle(s) valeur(s) les femmes rendent-elles service aux personnes âgées ? Dans quelle mesure ces valeurs masquent-elles la reconnaissance des activités d’(entr)aide en tant que travail ? Les données mobilisées sont issues d’une enquête qualitative portant sur les problématiques de maintien à domicile des personnes âgées dans les territoires de montagne en Suisse, dans le cadre de laquelle des entretiens ont été conduits auprès de professionnelles du domaine sanitaire et social, de bénévoles oeuvrant dans des associations locales et d’élues communales. Faisant l’hypothèse d’une volontarisation de l’action publique en faveur des personnes âgées, cet article analyse, au prisme du concept de « bénévolat gris », la façon dont les femmes prennent en charge l’accompagnement des personnes âgées dans l’espace local. Ce faisant, il montre comment les solidarités de proximité qui fondent les groupes d’(entr)aide locale en milieu rural reposent sur le travail gratuit des femmes.
Mots clés : bénévolat, vieillesse, genre, rural, Suisse
EN : This article explores the practices and perceptions of community assistance, focusing on women involved in caregiving for the elderly within Alpine villages in Switzerland. What values drive women to provide such services ? And how do these values impact the recognition of caregiving as labor? The research draws on qualitative data gathered from a study on eldercare in Switzerland’s mountainous regions. Interviews were conducted with various stakeholders including health and social care professionals, volunteers from local organizations, and elected officials. With the premise that public support for the elderly is increasingly reliant on women’s voluntary efforts, the article examines the concept of “grey volunteering” to analyze how they assume the responsibility of helping the elderly in local communities. The article reveals the reliance on women’s unpaid labor in rural areas as the foundation for the local solidarity networks supporting aging communities.
Keywords: volunteering, ageing, gender, rural, Switzerland