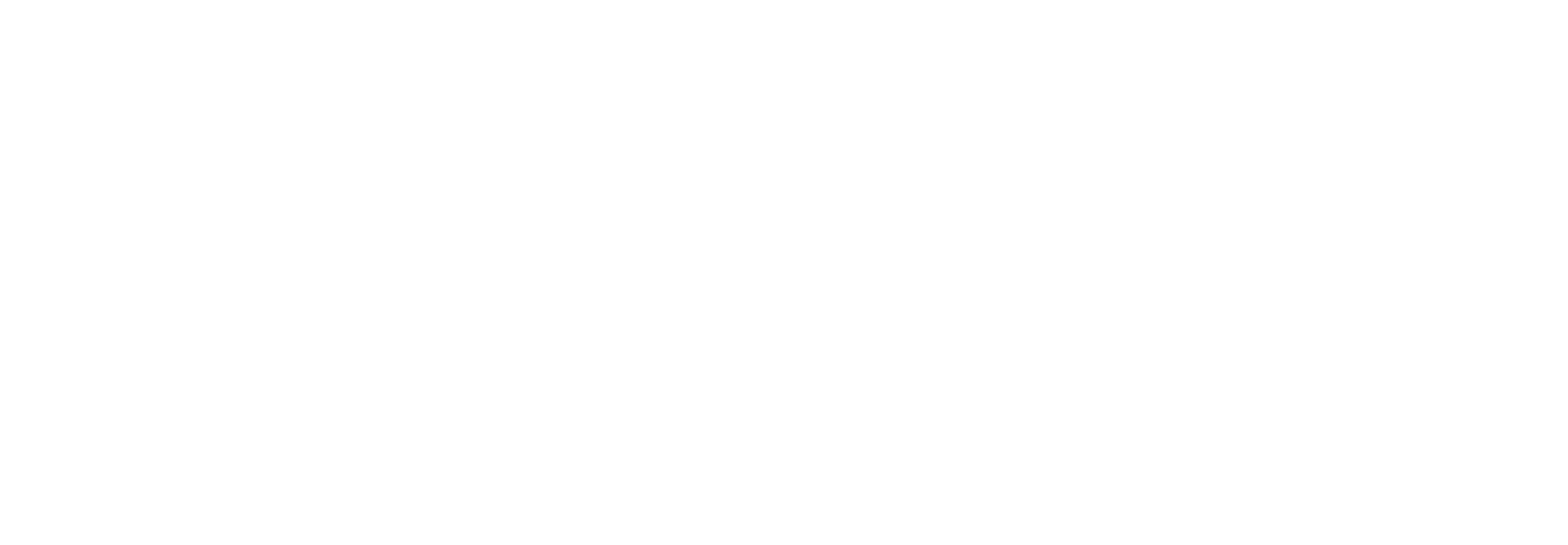APPEL LSP97 | Socialisation et (dé)politisation de l’économie
AUTOMNE 2026
Sous la direction de Jessy Bailly (ICP/MESOPOLHIS) et Xavier Leloup (INRS-UCS)
Il y a dix ans, Lien social et Politiques publiait un numéro sur les utopies économiques (Hély et Lefèvre, 2014). Ce numéro interrogeait entre autres choses la sociogenèse des idées économiques et la politisation des idées/faits économiques. Depuis sa parution, les politiques économiques n’ont cessé de faire l’objet de débats politiques et académiques, autant en raison des événements qui ont marqué la dernière décennie (renforcement des inégalités, concentration accrue de la richesse, inflation, crise sanitaire et parenthèse keynésienne) qu’en raison de la montée des préoccupations et politiques de « droite » dans les champs politiques en Europe et en Amérique (néo-libéralisme, austérité, libertarianisme, Brexit).
Dans ce contexte, il semble opportun et urgent de se pencher à travers un nouveau numéro de la revue qui interroge les entreprises (au sens de mise en œuvre d’un projet) sociales et politiques portées par des acteurs variés visant à manier, contester, se réapproprier les schèmes de ce qui doit être au principe d’une « bonne » gestion économique de la société. Le dossier souhaite toutefois le faire en mobilisant principalement le thème de la socialisation au sens large (autant dans ses dynamiques primaires que secondaires) en sollicitant des analyses empiriques et théoriques qui interrogent les dimensions sociologiques et politiques de la production des « catégories de l’entendement économique » (Lima, 2016) par une série d’acteurs qui les portent publiquement : économistes et militants hétérodoxes, qu’ils soient anticapitalistes — collectifs anti-austérité, des mouvements communalistes ou municipalistes, de différentes mouvances alternatives comme l’écoféminisme ou les communautés intentionnelles, par exemple — ou plus compatibles avec l’économie sociale et solidaire. Pour compléter ce panorama sur les principes de vision et de division des politiques économiques, on peut aussi penser aux néo/ordolibéraux et autres producteurs de l’orthodoxie économique (parmi certains segments d’acteurs peuplant les banques centrales et les institutions économiques nationales et internationales, les think-tanks et les clubs, par exemple), de même que les porteurs des pensées libertariennes.
Le dossier vise moins à se focaliser sur la circulation transnationale des idées économiques (Blyth, 2013 ; Helgadóttir, 2016 ; Laval et Dardot, 2010) qu’à questionner « par le bas » (à hauteur d’acteurs) comment ceux-ci se réapproprient des discours et des représentations sur les politiques économiques telles qu’elles devraient être (à l’image du travail d’E. Thompson sur l’économie morale des paysans : 1988). On souhaite sonder ces univers hétérogènes de goûts et de dégoûts sur la manière d’administrer l’économie, autrement dit de représentations économiques — qu’ils renvoient au souhait d’instituer des utopies économiques (Hély et Lefèvre, 2014), ou de défendre corps et âme l’orthodoxie économique — en veillant à les interroger à partir des propriétés sociales et biographiques des acteurs. Cette entrée par la socialisation à l’économie nous permet d’enrichir les travaux sur la socialisation. On pourra ainsi se pencher sur les processus d’incorporation, de transmission et d’acquisition des dispositions sociales (B. Lahire, 2002 ; W. Lignier, 2023), et sur les instances (continues) de socialisation à travers lesquelles cette incorporation peut s’opérer (sur différentes instances de socialisation voir : M. Darmon, 2010, A. Percheron, 1974, C. Dubar, 2022 et plus récemment C. Gousset, 2021).
Ce numéro voudrait toutefois insister, de manière complémentaire aux travaux sur la socialisation politique, sur les processus d’acquisition des principes de vision et de division du monde social appréhendés via une grille d’analyse économique : répartition des richesses, (in)justices fiscales et budgétaires, rôle de la monnaie (et des monnaies alternatives ou cryptomonnaies) et de l’inflation, principes d’une concurrence juste entre opérateurs économiques, modalités alternatives de financement public en dehors de la fiscalité et de la dette de marché : Lemoine, 2016, la distribution de biens essentiels (comme les biens alimentaires : Beurois, 2022), et plus largement rôle de l’État dans la gestion de l’économie (trop invasif ou à l’inverse, sous le joug d’une emporocratie[1]).
L’entrée par la socialisation à l’économie vise à enrichir les travaux sur la socialisation politique, en se demandant : le militantisme sur des objets économiques est-il exclusivement un militantisme virtuose (comme on l’observe dans les travaux sur l’Association pour la Taxation des Transactions financières et l’Action Citoyenne/ATTAC et plus largement l’altermondialisme : Filleule et coll., 2004) ? Adopter un tel point de vue négligerait cependant tout un ensemble de travaux sur des formes plus populaires de militantisme (comme le mouvement des Gilets jaunes, ou des mouvements de travailleurs). De la même manière, interroger la socialisation à l’économie — et la manière dont des acteurs fondent, reprennent et hybrident des catégories de l’entendement économique — permet d’analyser à nouveaux frais des mouvements qui ont été trop rapidement classés dans des causes post-matérialistes (que l’on pense aux féministes ou aux écologistes). On peut également s’interroger, en comparant plusieurs mouvements ou collectifs, quelles sont leurs bibliothèques de références symboliques relatives à l’économie : des économistes militants hétérodoxes, comme on peut l’observer dans le mouvement anti-dette publique, des économistes critiques grand public (comme T. Piketty), ou, à l’inverse, des économistes plus orthodoxes ? Certains collectifs sont-ils « omnivores », piochant dans plusieurs segments de références au sein du champ économique (Lebaron, 2000) ? Plus largement, il s’agit d’interroger comment ces acteurs se sont formés à l’économie : via des magazines et la presse économiques (Duval, 2004), que ce soit des titres instituant une « pédagogie économique » de l’acteur rationnel (pour reprendre l’expression de V. Gayon et B. Lemoine, 2013), ou des contenus plus critiques (Alternatives économiques par exemple) ? Via les universités d’été de partis anticapitalistes, ou au contraire au contact des adhérents du MEDEF ? Pour les plus diplômés, se sont-ils formés dans des cursus académiques valorisant l’économétrie, ou tout à l’inverse, dans des lieux universitaires où ils ont reçu des enseignements économiques hétérodoxes, faisant de ces professeurs des alliés de politisation de l’économie ?
Pour compléter le panorama des sites et instances de socialisation à l’économie, on peut également s’interroger sur les effets de dispositifs d’action publique et éducative (on pense du côté français à Educfi[2] ou aux « journées de l’économie » ; Angeletti, 2011), sur les situations d’autodidactie (parfois militantes) relatives à l’apprentissage économique (et notamment dans la gestion d’expériences de communs urbains : Furukawa Marques et Folco, 2023 : Lefèvre et Grant-Poiras, 2023), ou encore, en miroir de la socialisation politique (A. Percheron), à la transmission familiale de principes légitimes de vision économique. Car en détournant P. Bourdieu, on peut dire qu’il n’y a pas de « connaissance infuse de l’économique » (1977). C’est bien ce qu’éclaire L. Lima (2016) lorsqu’elle met en valeur que « La vision de l’ordre économique qui est indissociablement un ordre social (que l’on prenne la hiérarchie des métiers par exemple) se forge très tôt dans l’enfance par l’influence croisée des discussions familiales, des classements scolaires et des amitiés socialement discriminées ». On peut évidemment interroger le rôle des espaces professionnels (Dubar, 2022) et des « sous-mondes institutionnels spécialisés » (Berger et Luckmann, 2022) dans la socialisation aux principes économiques légitimes (on peut notamment penser à certaines structures de l’économie sociale et solidaire : Hély et Lefèvre, 2014 ; Furukawa Marques et Folco, 2023).
La sociologie des entreprises de (dé)politisation de l’économie est une entrée d’autant plus pertinente, qu’en plus de pouvoir contribuer autrement aux travaux sur la socialisation, l’on sait que l’économie est une ressource politique qui a, depuis plusieurs décennies, pénétré l’économie légitime des savoirs d’État (Dulong, 1996 ; Gouarné et coll., 2021 ; Alayrac, 2022), à un point tel point que l’on parle désormais « d’économicisation de l’action publique » (Gayon, 2022). Par ailleurs, les questions socioéconomiques donnent lieu à un clivage persistant et marqué. Les polarités et polarisations sur les imaginaires et représentations plurielles de ce que doit être l’économie, et du rôle des pouvoirs publics dans l’administration des biens économiques, sont par exemple visibles dans les travaux portant sur la fiscalité (Spire, 2018), mais pas seulement. Du côté des hétérodoxies, on peut aussi penser aux travaux de S. Babb sur le mouvement syndicaliste états-unien en faveur du « green backism » (1996) ; le mouvement de l’économie sociale et solidaire au Québec (Hély et Lefevre, 2014), l’écoféminisme et la valorisation des économies de subsistance (Pruvost, 2019), le mouvement anti-dette (Ambrose, 2006 ; Sorg, 2022 et l’altermondialisme : Agrioliansky et coll., 2005 ; Dupuis-Déri, 2009), le mouvement contre la Directive Bolkenstein (Crespy, 2010), les mouvements anti-austérité (travaux de P. Gerbaudo, 2017 ; D. Della Porta, 2015 ou J. Bailly, 2022), la campagne contre le TTIP (Oleart, 2021) et plus récemment, les Gilets jaunes (Ravelli et al., 2024).
Les contributions attendues pour ce numéro peuvent porter sur différents types de discours économiques, qu’ils soient hétérodoxes ou orthodoxes, incluant les travaux sur les libertariens, un univers idéologique moins couvert à ce jour dans la littérature scientifique. Elles pourront aborder des thèmes transversaux liés à la socialisation afin d’explorer et mieux comprendre comment ces discours se constituent : quel est le rôle des biographies et des trajectoires — en quelque sorte de la constitution de positions — pour expliquer ces prises de position économiques, dans le débat public ? Qu’est-ce que les carrières (selon H. Becker, 1985) ou les trajectoires (selon A. Strauss, 1992) ont à nous apprendre sur les discours économiques de divers entrepreneurs sociaux et politiques ? Quelles instances de socialisation jouent un rôle dans l’intériorisation et la constitution de discours économiques ? Par exemple, quel rôle peut avoir la socialisation primaire, au sein de la famille ou à l’école, sur l’adhésion des individus à certains discours économiques ? Quel rôle peut avoir la socialisation à l’économie dans le développement du rapport à l’État et à la puissance publique ? On sera évidemment soucieux, du point de vue des acteurs étudiés, du fait qu’ils peuvent connaitre des situations de tension lorsque les contenus socialisateurs de plusieurs instances de socialisation entrent en contradiction, et qui peuvent provoquer des points d’inflexion ou des ruptures biographiques (et dans le discours économique et les prises de position publiques).
Les contributions pourront s’inscrire dans un des trois axes suivants qui identifient différentes positions idéologiques par rapport à l’économie. Ces trois axes ne sont pas exclusifs et le numéro accueillera les contributions qui aborderaient des positions qui ne se retrouvent pas dans l’une des trois déjà identifiées ici. Les questions posées par l’appel sont vues comme transversales à ces trois axes, par exemple, celle liée aux relations à entretenir avec l’État et la puissance publique, qui se pose tout autant pour certains entrepreneurs hétérodoxes qu’orthodoxes.
Axe 1 : sociologie des entrepreneurs et des représentations de l’hétérodoxie
Malgré un certain intérêt académique pour ces mobilisations économiques hétérodoxes, les cas d’études précités pourraient davantage être analysés en mobilisant les outils de la sociologie et plus précisément ceux portant sur la socialisation politique. On vise ainsi à ne pas limiter l’analyse de cadres (framing analysis) des mouvements organisés autour d’objets socioéconomiques, mais à l’étendre et l’articuler aux propriétés sociales des groupes étudiés[3], et à leurs trajectoires. Toujours du point de vue hétérodoxe, on a encore peu de travaux sociologiques sur les écosocialismes (et/ou écoféminismes) ou les courants municipalistes/communalistes du point de vue de leurs imaginaires économiques, qui s’efforcent de concilier politique économique et justice environnementale et sociale. On peut aussi interroger les acteurs et les lieux de l’économie sociale, au Québec ou en France. Ils peuvent aussi se constituer en des lieux de socialisation à l’économie, et par exemple à la valorisation des communs. On pense enfin au développement des savoirs économiques féministes (Pérez Orozco, 2014 ; Périvier, 2020) et à l’étude sociologique de leurs entrepreneurs qui constituent des cas particulièrement féconds pour l’étude de la socialisation à l’économie.
Axe 2 : une sociologie des « phobiques d’État »
À l’inverse, les travaux sur les réseaux libertariens (dont le rendement électoral semble porteur, ces dernières années des États-Unis à l’Argentine) ont moins fait l’objet de travaux académiques et surtout sociologiques (en partie sans doute en raison de la distance idéologique qui sépare les libertariens des praticien.ne,s des sciences sociales, distance qui pourrait elle-même faire l’objet d’analyse, entre autres, en s’interrogeant sur les entrepreneurs.e.s de discours économiques à l’œuvre au sein des universités, à travers les chaires, observatoires, et autres centres de recherche qu’ils et elles animent). . On peut toutefois mentionner des travaux portant sur des mouvements antifiscaux (Frau et Milet, 2022 ; Willmott, 2019). Ces derniers donnent toutefois à voir des univers d’acteurs et de représentations préconisant une dé-bureaucratisation et un effacement de l’État dans son versant fiscal et redistributif. Ils s’opposent en cela aux discours des hétérodoxes qui ont davantage tendance à défendre une vision de l’État social. On pense évidemment à Contribuables associés ou à l’IFRAP par exemple. Il s’agit dès lors de se demander si — et si c’est le cas, en quoi — les trajectoires biographiques des libertariens et autres « phobiques d’État » (Foucault, 2004) diffèrent radicalement de celles des hétérodoxes, et si ces divergences en termes de socialisation expliquent les différences dans les prises de position économique.
Axe 3 : la dépolitisation de l’ordre économique — une sociologie des entrepreneurs de discours néolibéraux
Le dossier est tout autant ouvert à des propositions d’articles portant sur des acteurs préconisant une dés-étatisation de la société (axe 2), que les relais d’un « nouvel interventionnisme libéral » pour reprendre la formule foucaldienne définissant le néolibéralisme (Foucault, 2002). Les seconds préconisent moins un retrait de l’État (libertarianisme, ultralibéralisme) qu’une transformation des formes d’intervention de l’État en faveur du maintien artificiel d’un ordre du marché (King et Le Galès, 2017).
L’intérêt porté à la sociologie de ces acteurs orthodoxes ou libertariens (axes 2 et 3) vise à renseigner comment ceux-ci dépolitisent (Robert, 2021)la gestion de l’économie (et plus largement les politiques économiques) en adoptant une lecture univoque de ce que doit être le « bon » ordre économique (Borriello, 2014), désencastré — au moins dans le discours — du politique (Gayon et Lemoine, 2016), garanti par la « fiction de la neutralité du marché » (Lebaron, 2000). Un des procédés classiques de cette dépolitisation vise à faire l’homologie entre la gestion économique de/par l’État et celle du foyer domestique. Dans ce raisonnement par analogie, l’État doit gérer en « bon père de famille » (et il s’agit là d’opérer une homothétie entre gestion publique et privée, en désacralisant le public).
Dans ce numéro, l’on souhaite s’intéresser, d’une part, autant aux représentations variées de ce que doit être l’administration de l’économie qu’aux profils des acteurs qui les portent et, d’autre part, autant aux effets de la socialisation sur la formation des représentations de l’économie qu’aux effets liés à certains contextes (par exemple, certaines conjonctures économiques peuvent être largement (dé)favorables à certaines formes d’idéologie économique : c’est le cas du keynésianisme structurellement dévalué à partir de la fin des années 1960 (Gayon, 2022), qui a toutefois été reconvoqué dans une courte parenthèse pendant le COVID19 en Europe : Lemoine, 2022).
Cette entrée par la socialisation à l’économie — à des représentations économiques très hétérogènes — nous semble pertinente à plusieurs égards : pour réinterroger à nouveaux frais sur les rapports sociaux à l’État (via le juste rôle que celui-ci doit jouer dans la régulation économique), les goûts et dégoûts associés à l’économie de marché, la régulation juridique de l’économique, ou encore les liens sociaux matérialisés par des principes économiques d’échange, de production ou de propriété.
Indications complémentaires et calendrier
Quel que soit l’axe privilégié, les articles attendus reposeront sur les résultats de travaux empiriques en lien avec la thématique du numéro. Ils pourront aussi prendre la forme de contributions aux débats théoriques et méthodologiques.
Les auteur∙ices sont invité∙es à envoyer une proposition de contribution (1 à 2 pages, environ 6.000 signes), en précisant leur affiliation universitaire, avant le 15 juin 2025, aux deux responsables du numéro : Jessy Bailly (jessy.bailly@yahoo.fr) et Xavier Leloup (xavier.leloup@inrs.ca). Celles et ceux dont la proposition aura été retenue par le comité de rédaction seront invité∙es à soumettre un article complet pour le 1er décembre 2025. La parution du numéro thématique est prévue pour l’automne 2026.
La revue ne publie que des textes inédits. Les auteur∙ices sont tenu∙es d’aviser la rédaction de tout projet de publication concurrent.
Références bibliographiques
Agrikoliansky, Éric, Olivier Fillieule et Nonna Mayer. 2005. L’altermondialisme en France. La longue histoire d’une nouvelle cause. Paris, Flammarion.
Alayrac, Pierre. 2022. Une noblesse d’Europe : socio-histoire de l’autorité des économistes de la Commission européenne (1958–2019). Thèse de doctorat en science politique, EHESS.
Ambrose, Soren. 2006. « Social Movements and the Politics of Debt Cancellation », Chicago Journal of International Law, 6, 1 : 267-285.
Angeletti, Thomas. 2011. « Dire l’économie. Les “journées de l’économie” comme instance de confirmation », Sociologie. En ligne : https://journals.openedition.org/sociologie/943/.
Babb, Sarah. 1996. « A True American System of Finance: Frame Resonance in the U.S. Labor Movement, 1866 to 1886 », American Sociological Review, 61, 6 : 1033-1052.
Bailly, Jessy. 2022. « Reframing the debt crisis in defence of social democracy », Revue internationale de politique comparée, 29, 4 : 47-76.
Becker, Howard. 1985. Outsiders. Paris, Métailié.
Berger, Peter et Thomas Luckmann. 2022 [1966]. La construction sociale de la réalité. Paris, Armand Colin.
Beurois, Tom. 2022. « Une aide alimentaire apolitique ? Formes de (dé)politisation ordinaire au sein d’épiceries sociales en France et en Belgique », Participations, 33, 2 : 31-57.
Blyth, Mark. 2013. Austerity. The History of a Dangerous Idea. Oxford, Oxford University Press.
Borriello, Arthur. 2014. « L’abolition symbolique du politique, de nécessité vertu : les réformes budgétaires dans les discours du président du Conseil italien », Politique européenne, 44, 2 : 154-180.
Bourdieu, Pierre. 1977. « Questions de politique », Actes de la recherche en sciences sociales, 16 : 55-89.
Crespy, Amandine. 2010. « Contre “Bolkestein” : le Parlement européen entre idéologie et stratégie institutionnelle », Revue française de science politique, 60, 5 : 975-996.
Dalla Porta, Donatella. 2015. Social Movements in Times of Austerity. Bringing Capitalism Back into Protest Analysis. Cambridge, Polity Press.
Darmon, Muriel. 2010. La socialisation. Paris, Armand Colin.
Dubois, Claude. 2022. La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles. Paris, Armand Colin.
Dulong, Delphine. 1996. « Quand l’économie devient politique. La conversion de la compétence économique en compétence politique sous la Ve République », Politix, 35 : 109-130.
Dupuis-Déri, Francis. 2009. L’altermondialisme. Montréal, Éditions du Boréal.
Duval, Julien. 2004. Critique de la raison journalistique. Les transformations de la presse économique en France. Paris, Seuil.
Filleule, Olivier et Philippe Blanchard, Éric Agrikoliansky, Marko Bandler, Florence Passy et Isabelle Sommier. 2004. « L’altermondialisation en réseaux. Trajectoires militantes, multipositionnalité et formes de l’engagement : les participants du contre-sommet du G8 d’Évian », Politix, 68, 4 : 13-48.
Foucault, Michel. 2004. La naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979). Paris, Seuil.
Frau, Caroline et Marc Milet. 2022. « Les mobilisations anti-fiscalistes », dans Guillaume Courty et Marc Milet (dir.). Les groupes d’intérêt en France. Paris, Classiques Garnier : 355-368.
Furukawa Marques, Dan et Jonathan Durand Folco. 2023. Les communs au Québec : initiatives collectives citoyennes et autogestion, d’hier à aujourd’hui, Recherches sociographiques, 64, 1 : 7-256.
Gayon, Vincent. 2022. Épistémocratie. Enquête sur le gouvernement international du capitalisme. Paris, Raisons d’Agir.
Gayon, Vincent et Benjamin Lemoine. 2013. « Pédagogie économique », Genèses, 93, 4 : 2-7.
Gayon, Vincent et Benjamin Lemoine. 2014. « Maintenir l’ordre économique. Politiques de désencastrement et de réencastrement de l’économie », Politix, 105, 1 : 7-35.
Gerbaudo, Paolo. 2017. The Mask and the Flag. Populism, Citizenism and Global Protest. Oxford, Oxford University Press.
Gouarné, Isabelle, Mathieu Hauchecorne, Emmanuel Monneau et Antoine Vion. 2021. « L’État des économistes. La science économique face à la puissance publique (XXe–XXIe siècles) », Politix, 133, 1 : 7-27.
Gousset, Cyriac. 2021. « Introduction du dossier. Médias, socialisation et formation des dispositions », Politiques de communication, 17, 2 : 5-24.
Helgadóttir, Oddný. 2016. « The Bocconi boys go to Brussels: Italian economic ideas, professional networks and European austerity », Journal of European Public Policy, 23, 3 : 392-409.
Hély, Matthieu et Sylvain Lefèvre. 2014. « Présentation : utopies économiques », Lien social et Politiques, 72 : 3-16.
King, Desmond et Patrick Le Galès. 2017. Reconfiguring European States in Crisis. Oxford, Oxford University Press.
Lahire, Bernard. 2011. L’homme pluriel. Les ressorts de l’action. Paris, Nathan.
Laval, Christian et Pierre Dardot. 2010. La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale. Paris, La Découverte.
Lebaron, Frédéric. 2000. La croyance économique. Les économistes entre science et politique. Paris, Seuil.
Lefèvre, Sylvain et David Grant-Poitras. 2023. « L’utopie (très) concrète du Bâtiment 7 : un commun face aux défis de son autonomie financière », Recherches sociographiques, 64, 1 : 91-117.
Lemoine, Benjamin. 2016. L’ordre de la dette. Les infortunes de l’État et la prospérité du marché. Paris, La Découverte.
Lemoine, Benjamin. 2022. La démocratie disciplinée par la dette. Paris, La Découverte.
Ligner, Wilfried. 2023. La société est en nous. Comment le monde social engendre des individus. Paris, Seuil.
Lima, Léa. 2016. « Les catégories de l’entendement économique dans la tradition sociologique française », Idées économiques et sociales, 183, 1 : 6-12.
Oleart, Alvaro. 2021. Framing TTIP in the European Public Spheres. Towards an Empowering Dissensus for EU Integration. Cham, Palgrave Macmillan.
Percheron, Annick. 1974. « Socialisation et socialisation politique », dans Annick Percheron (dir.). L’univers politique des enfants. Paris, Presses de Sciences Po : 3-24.
Pérez Orozco, Amaia. 2014. Subversión feminista de la economía. Madrid, Traficante de Sueños.
Périvier, Hélène. 2020. L’économie féministe. Paris, Presses de Sciences Po.
Pruvost, Geneviève. 2020. « Penser l’écoféminisme. Féminisme de la subsistance et écoféminisme vernaculaire », Travail, genre et sociétés, 42, 2 : 29-47.
Ravelli, Quentin, Johanna Siméant-Germanos, Loïc Bonin et Pauline Liochon. 2024. Les Gilets jaunes. Une révolte inclassable. Paris, Éditions ENS.
Robert, Cécile. 2021. Confiner la démocratie. Les dépolitisations de l’action publique. Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion.
Sorg, Christoph. 2022. Social Movements and the Politics of Debt. Transnational Resistance against Debt on Three Continents. Amsterdam, Amsterdam University Press.
Spire, Alexis. 2018. Résistances à l’impôt, attachement à l’État. Paris, Seuil.
Strauss, Anselm. 1992. La trame de la négociation. Sociologie qualitative et interactionnisme. Paris, L’Harmattan.
Thompson, Edward P. 1988. « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », dans Florence Gauthier et Guy-Robert Ikni (dir.). La guerre du blé au XVIIIe siècle. Paris, Les Éditions de la Passion : 31-92.
Willmott, Kyle. 2019. « Mobilizing Political Strategy. The Global Practices of Taxpayer Groups », dans David H. Laycock (dir.). Political Ideology in Parties, Policy, and Civil Society: Interdisciplinary Insights. Vancouver, UBC Press : 132-148.
[1] Sur la reprise du concept aristotélicien de Karl Marx : Henri Peña-Ruiz, Karl Marx, penseur de l’écologie, Paris, Seuil, 2018.
[2] https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A17251
[3] Dans un article récent, D. Della Porta propose de faire l’« économie politique » de mobilisations sociales en s’interrogeant sur la composition socioéconomique des manifestants (« Political economy and social movement studies: The class basis of anti-austerity protest », Anthropological Theory, Vol. 17(4), p. 453–473). Elle ne lie toutefois pas la vision économique de ces manifestants à leurs propriétés sociales et encore moins à des réflexions sur les processus d’acquisition de ces schèmes économiques. On sait pourtant que la correspondance entre position et prise de position ne sont pas automatiques (dans la mesure où les individus sont « pluriels » pour reprendre Lahire, 2002.)