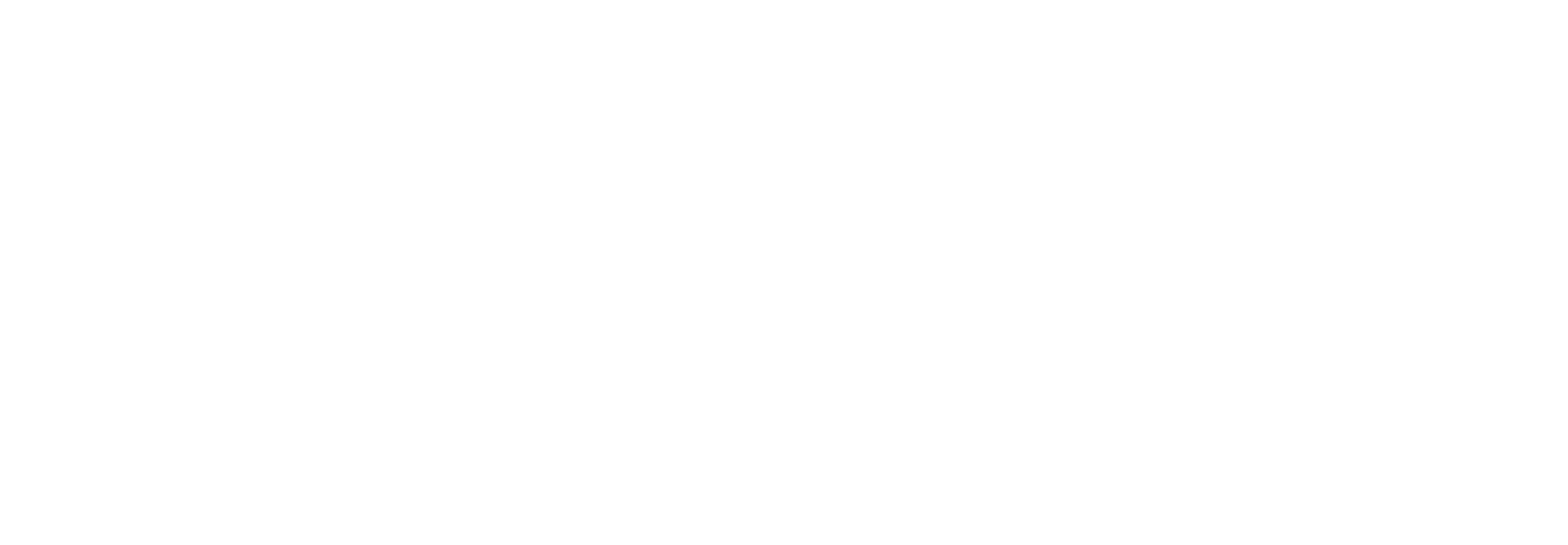Limites et défis du recours au modèle coopératif dans la mise en œuvre des politiques étatiques d’habitation
Article complet du #87 | Inégalités d’appropriation du logement et de l’habitat
FR : Dans le cadre de la refonte des pouvoirs des villes entreprise par le gouvernement provincial québécois, la Ville de Montréal s’est vue octroyer en 2016 le statut de métropole. Certaines responsabilités jusqu’alors provinciales lui ont été transférées, dont l’administration des enveloppes budgétaires dédiées à la réalisation de nouveaux logements d’habitation sociaux et communautaires. À la lumière de ce changement de paradigme historique qui confère à l’administration municipale la possibilité de se doter d’outils de planification, d’orientation et de réalisation de son parc de logements sociaux, cet article s’intéresse aux coopératives d’habitation en tant qu’outil privilégié sur le territoire montréalais pendant les 20 dernières années. Il se propose d’analyser l’exploitation d’une coopérative comme une forme de sous-traitance de l’État : ce dernier confie à des ménages à faible et modeste revenu la responsabilité d’offrir à ces mêmes ménages des logements abordables et de les gérer. Pour mieux comprendre comment les membres-locataires engagés dans la gouvernance de leur coopérative vivent les limites de cette forme d’autogestion, nous présenterons les résultats de onze entrevues individuelles menées à l’hiver 2019 auprès de membres ou d’ex-membres de conseils d’administration de onze coopératives d’habitation. Ces dernières permettent de dresser un bilan tiède comportant plusieurs critiques sur l’insuffisance de l’action gouvernementale pour offrir des programmes efficaces, mais également sur les limites et les défis du modèle coopératif. Celui-ci s’accompagne de plusieurs paradoxes, notamment quant à la sélection des membres et à leur implication au sein du projet résidentiel où ils habitent. Ainsi, l’empowerment, la prise en charge collective et la gestion démocratique apparaissent pour des répondant·es davantage comme des idéaux à atteindre que comme une réalité caractéristique du quotidien.
Mots-clés : logement social, coopératives d’habitation, Montréal, politiques publiques, enjeux
EN : As part of the overhaul of the powers of cities undertaken by the Quebec provincial government, the city of Montreal was granted in 2016 the status of metropolis and transferred specific responsibilities in housing, including the administration of the budget envelopes dedicated to the realization of new social and community housing units. A In light of this historical paradigm shift which gives the municipal administration the possibility of acquiring tools for planning, orienting and building its social housing stock, this article focuses on housing cooperatives. as a privileged tool in Montreal for the past 20 years. It proposes to analyze the operation of a cooperative as a form of subcontracting of the State, while the latter entrusts the responsibility of providing and managing affordable housing for low and modest income households to these same households. To better understand how the member-tenants involved in the governance of their project experience the limits of this self-management, we will present the results of 11 individual interviews carried out in winter 2019 with members or former members of the board of directors of 11 different housing cooperatives. These allow us to draw up a lukewarm assessment comprising several criticisms of the inadequacy of government action to offer effective programs, but also of the limits and challenges of the cooperative model. This is accompanied by several paradoxes, especially in the selection of members and their involvement in the project they inhabit. Thus, empowerment, collective responsibility and democratic management appear to respondents more as ideals to be achieved than a reality that transcends everyday.
Keywords: social housing, housing cooperatives, Montreal, public policies, challenges
Article complet du #87 | Inégalités d’appropriation du logement et de l’habitat