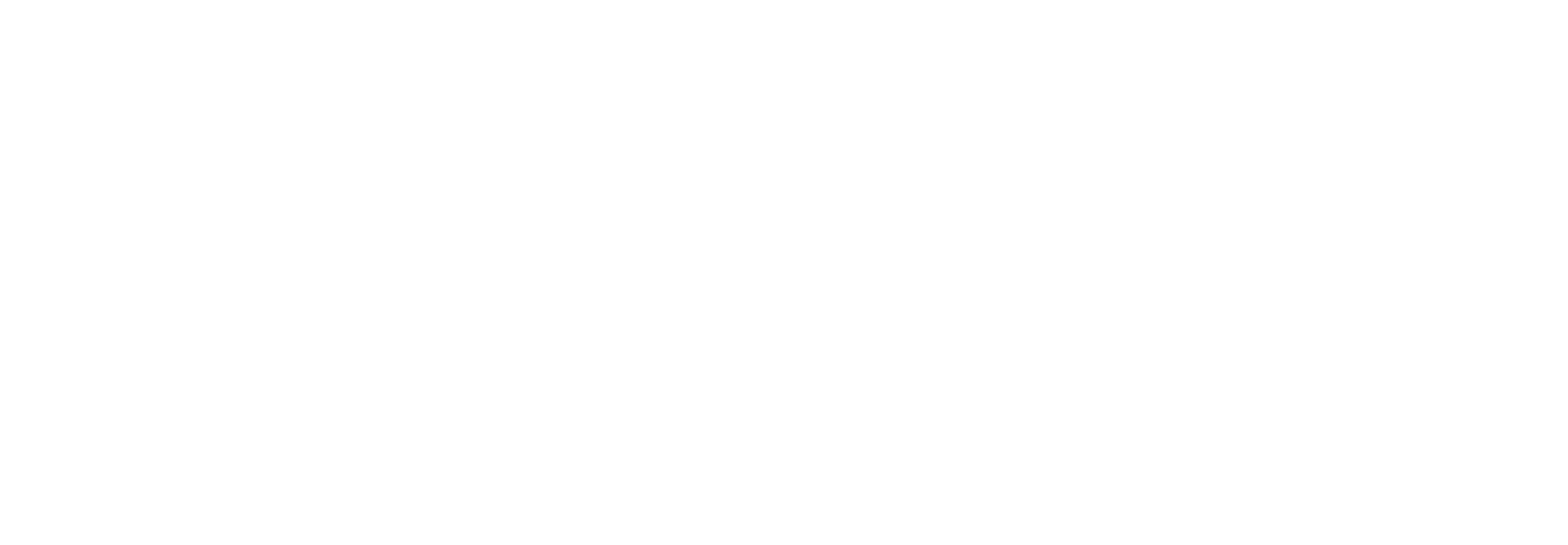Des agents locaux aux prises avec une catégorie floue d’action publique. Enquête sur la « santé publique » dans une commune populaire de la banlieue parisienne
Article complet du #78 | Santé et politiques urbaines
Résumé
À partir d’une enquête menée dans une commune populaire de la banlieue parisienne, cet article porte sur le travail des agents intermédiaires, municipaux et associatifs, responsables des politiques locales de « santé publique ». Ni professionnels de santé, ni travailleurs sociaux, ces agents – majoritairement des femmes, « cheffes de projet » ou « chargées de mission » – se situent entre les élites administratives et les agents subalternes. Il s’agit d’étudier la façon dont elles définissent et investissent cette catégorie qu’est la santé publique, qui fait objet de luttes, dans un contexte marqué par les réformes de l’État social et la « territorialisation » de l’action publique. En analysant leurs positions et dispositions, on montre comment ces agents aux missions floues et aux compétences hybrides, sont confrontés à des conditions d’emploi et de travail précaires et instables qui jouent sur leur manière de faire de la « santé publique » à l’échelle locale. La mise en cohérence de leurs pratiques, notamment par les chiffres, permet à ces salariées à cheval entre espaces municipal et associatif de créer de l’unité et de faire face à l’incertitude des financements. Tout en les critiquant, elles s’approprient les logiques de gestion venues des sommets de l’État – celles du « nouveau » management public et de la politique de la ville – pour pouvoir maintenir leurs activités, en cohérence avec leur engagement en faveur de la « santé communautaire » et de la « participation des habitants ».
Mots-clés : Travail, agents intermédiaires, classes sociales, santé publique, action publique locale, municipalités, associations, engagement, quartiers populaires, État social, politique de la ville, territorialisation
Abstract
Based on fieldwork in a poor community north of Paris, this paper focuses on intermediaries in charge of « public health » local policies, either in the local public sector or in non-profit organizations. Neither health specialists nor social workers, these actors, mostly women, are “project managers.” They work at an intermediate level, between senior officials and subordinate employees. The aim of this article is to study how they contribute to defining “public health” programs in the context of welfare State reforms and of the “territorialization” of public policies. It analyzes the positions and the dispositions of these intermediaries who have unclear missions and hybrid skills. It shows how unstable working conditions impact the way they implement public health policies at the local level. The use of numbers allows them to give coherence to their practices and to deal with uncertain funding. In doing so they embrace the managerial forces promoted by the new public management and the city policies, while criticizing them. They can secure their position and activities, thus continuing their commitment to “empower” residents.
Keywords: Work, intermediaries, social class, public health, local public policies, municipalities, non-profit rganizations, commitment, poor communities, Welfare State, urban policies, territorialization