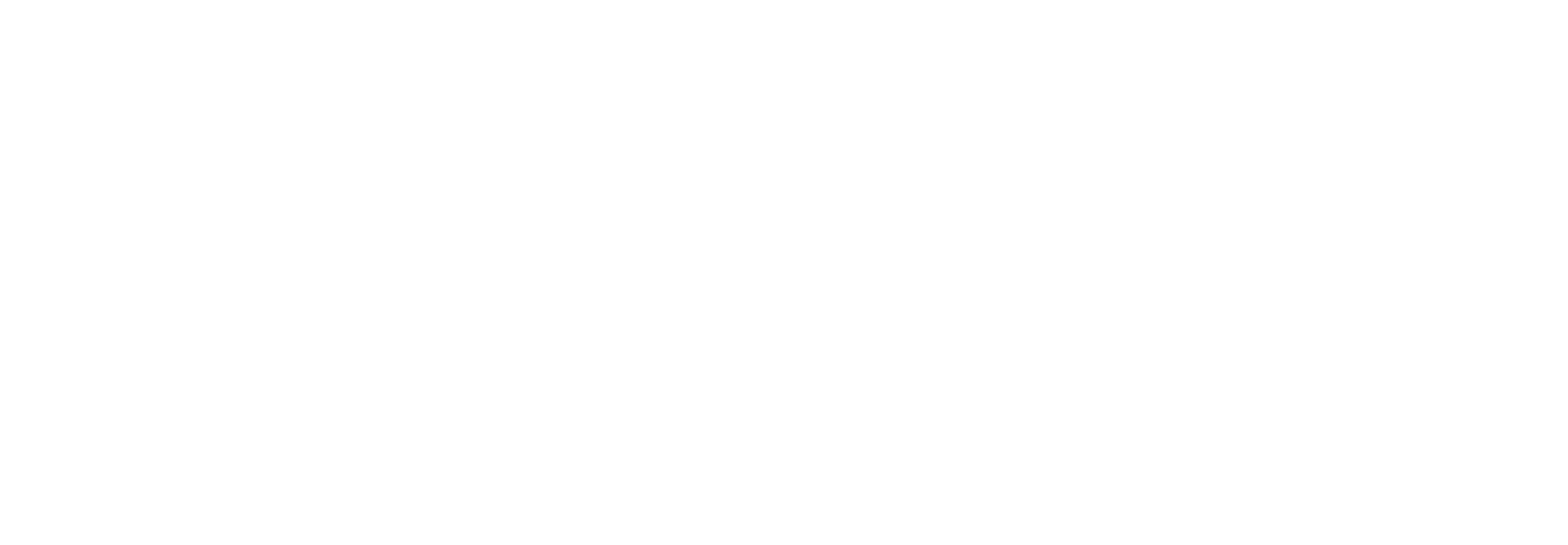APPEL LSP98 | Les gauches et les démocraties dans la tourmente
PUBLICATION AU PRINTEMPS 2027
Sous la direction de Pascale Dufour (Université de Montréal), Héloïse Nez (Université Paris Cité) et Thomas Collombat (Université du Québec en Outaouais)
Depuis 2008 et les soubresauts du capitalisme financier, la gauche et le centre gauche des démocraties représentatives d’Europe et d’Amérique semblent avoir plus de difficultés à conquérir le pouvoir et à appliquer un programme de transformation sociale. Si les mouvements d’occupation des places publiques des années 2010 inscrivaient la justice sociale et la « démocratie réelle » au cœur de leurs revendications (Della Porta et Mattoni, 2014 ; Ancelovici et coll., 2016 ; Nez, 2022), imprégnant ainsi les termes du débat public de manière progressiste, la décennie 2020 est davantage marquée par la diffusion des idées et des gouvernements d’extrême droite. En Pologne, en Hongrie, en Turquie, en Israël, aux États-Unis, au Brésil ou encore en Argentine, ce sont des « démocraties défectueuses » (Çetin, 2023) qui sont en place où des régimes illibéraux confisquent droits civiques et libertés politiques (Demias-Morisset, 2024). Partout, la « fenêtre d’Overton » (qui désigne les idées considérées comme acceptables dans le débat public) se déplace largement vers la droite du spectre politique, conséquence d’une droitisation des champs intellectuels et médiatiques (Tiberj, 2024), rendant audibles (et légitimes) des discours jusque-là bannis, notamment à propos des migrations, du racisme, des personnes vulnérables ou des droits des femmes et des personnes LGBTQ+. Les gauches de gouvernement n’ont plus le vent en poupe, même si des exceptions se prolongent, en Uruguay ou en Espagne, par exemple (Foucraut, 2023).
Ce numéro s’intéresse aux gauches sous toutes leurs formes, c’est-à-dire l’ensemble des forces de transformation sociale, allant des organisations réformistes aux groupes révolutionnaires (partis politiques, syndicats ou mouvements sociaux structurés ou non). Que deviennent-elles dans le contexte politique de droitisation et de fragilisation des démocraties représentatives, qu’il s’agisse des gauches partisanes ou extra-parlementaires ? Qu’advient-il des gauches traditionnelles, notamment sociales-démocrates, dont la place centrale dans l’échiquier politique est de plus en plus remise en cause ? Les gauches de mouvement social en rupture plus claire avec le capitalisme ont-elles réussi leur pari de recomposition du champ partisan ? À l’extérieur du terrain électoral, comment les forces progressistes cherchent-elles à réanimer un projet de société alternatif, et avec quels moyens ? Que reste-t-il des mobilisations anti-austérité et pro-démocratie qui se sont diffusées à l’échelle mondiale dans la décennie 2010, depuis les « printemps arabes » jusqu’à l’estallido chilien, en passant par les Indignados, Occupy, le Printemps érable québécois, Gezi Park ou encore la révolte des parapluies à Hong Kong ? Que sont devenus les « partis-mouvements » et les expériences de municipalisme qui se sont inscrits dans le sillage de certains de ces mouvements ? Comment et pourquoi les gauches remettent-elles le travail politique sur le métier ?
Ces bouleversements politiques ne sont pas nouveaux, ni spontanés. Ils s’inscrivent dans des processus politiques de long terme, où désastres écologiques et baisse tendancielle des voies sociales-démocrates sont visibles depuis (au moins) les années 1970 (Pontusson, 1992 ; Rothstein et Steimo, 2013 ; Frega, 2021). La gauche traditionnelle est aussi contestée par les perspectives décoloniales qui sont le résultat d’une histoire coloniale au long cours et actualisent des réalités empiriques et des expériences d’inégalités qui ont accompagné la genèse de l’État moderne (Escobar 2018). Ces inégalités se déploient par ailleurs dans un contexte de backlash antiféministe, raciste, transphobe et homophobe qui semble s’accélérer (Off, 2023 ; Kuhar et Paternotte, 2018 ; Liu and al., 2021).
Quels sont les rôles des gauches politiques et sociales, au-delà des résistances ? Quelles tensions permettent-elles d’explorer, en dehors des moments ou entre les moments de crise, entre résistances et alternatives ? Et dans le cas où des alternatives politiques et sociales émergent, notamment au niveau local, via l’autogestion, des stratégies anticapitalistes ou des innovations démocratiques, en référence par exemple au municipalisme ou au communalisme (Cossart et Sauvêtre, 2020 ; Verdier et coll., 2021), comment les gauches cristallisent-elles ces expériences et permettent-elles un changement d’échelle des initiatives populaires ? Comment se renouvellent des utopies de gauche, des « utopies réelles » dans leurs stratégies de rupture, interstitielle et/ou symbiotique (Olin Wright, 2010, 2020 ; Shulz et coll., 2024) ? Et comment se construisent des alliances entre différents groupes sociaux, entre partis politiques, mouvements sociaux et organisations syndicales ?
Ce numéro propose d’adopter une perspective large d’analyse des gauches, allant de leurs dimensions les plus institutionnelles et réformistes à celles plus innovatrices et transformatrices, voire expérimentales. Nous cherchons à identifier les dynamiques, les interactions et les contradictions pouvant exister entre ces différentes manifestations, tout en les pensant de façon critique et en interrogeant leurs capacités à restructurer une réponse théorique et pratique aux défis posés tant par le capitalisme que par les discours d’exclusion en provenance des nouvelles droites, sur les scènes politiques, électorales et médiatiques. Il s’agira notamment d’explorer les liens entre les expérimentations locales des différentes traditions progressistes (incluant aussi bien les expériences anticapitalistes, des communs, que des prises de pouvoir au niveau local), l’arrimage possible ou non avec le niveau national de gouvernance et les constructions de solidarités transnationales entre groupes ou réseaux.
On l’aura compris, « les gauches » comprises dans leur pluralité ne désignent pas juste la gauche partisane, mais constituent aussi une ouverture vers les sociétés civiles -en émergence, en réseau, organisées ou en voie d’institutionnalisation. Nous partons du postulat qu’il est nécessaire et fructueux analytiquement de regarder les gauches par plusieurs lorgnettes, afin de prendre la mesure de la capacité des mouvements populaires à obtenir des gains ou à proposer des alternatives, même si le gouvernement en place n’est pas « allié » et afin de comprendre les transformations et renouvellements en cours.
Plus spécifiquement, nous invitons des contributions, ancrées dans plusieurs champs disciplinaires (économie, histoire, anthropologie, sociologie, science politique, philosophie) ou offrant une perspective interdisciplinaire, sur une diversité de cas à l’international, autour de trois axes de réflexion.
Axe 1 : Les utopies politiques des gauches en transformation
Un des apprentissages récents de la recherche sur les formes radicales du militantisme a souligné la difficulté de ce type d’engagement à se projeter dans l’utopie, tant le futur politique paraît menacé et la destruction des écologies profonde. Par ailleurs, une grande partie des gauches semble mobilisée de façon réactive ou défensive face au « backlash » réactionnaire et « anti-woke » apparu à la suite notamment des mouvements Black Lives Matter, #metoo ou d’affirmation des droits des personnes trans. Dans ce contexte, assiste-t-on malgré tout à une recomposition des contenus progressistes, quels que soient les traditions de pensée, les emprunts, les appropriations et les futurs imaginés (anticapitalisme libertaire ou non, écosocialisme, féminisme, écoféminisme, marxisme 2,0, altermondialisme revisité, etc.) ? Près de 40 ans après la chute du « socialisme réel », comment les idées de planification et de coordination économiques se renouvellent-elles, en lien notamment avec l’écologie (Laurin-Lamothe et coll., 2023 ; Durand et Keucheyan, 2024) ? L’écosocialisme réussit-il la synthèse des revendications sociales et environnementales (Gorz, 2008 ; Kovel, 2007) ? Dans quelle mesure les contradictions de et entre certaines approches créent-elles des obstacles à la convergence des luttes à gauche ? La décroissance peut-elle devenir un horizon commun des gauches ou les contradictions économiques en auront-elles raison (Abraham, 2019) ? Bref, la gauche peut-elle penser ses utopies malgré un contexte marqué par des postures défensives et la sauvegarde d’acquis issus des luttes ouvrières de l’ère industrielle ?
Axe 2 : Penser les complémentarités entre les syndicats, les mouvements progressistes et les partis politiques
Les schémas traditionnels de la gauche impliquaient des articulations assez institutionnalisées entre partis et mouvements, même si elles pouvaient connaître des variations dans le temps et suivant les contextes sociopolitiques. Que l’on parle de travaillisme ou d’alliances plus ponctuelles et informelles, le syndicalisme a toujours organisé son rapport au champ partisan de façon à faire porter ses revendications dans l’arène parlementaire sans pour autant perdre son indépendance politique. Qu’advient-il de ces schémas quand les partis sociaux-démocrates comme communistes sont affaiblis, voire marginalisés dans l’arène parlementaire (Collombat et Lafrance, 2022) ? Le parti politique des démocraties représentatives est-il toujours un bon véhicule pour porter les alternatives ? Comment réinventer cette forme partisane (Lefebvre, 2022 ; Gaxie et Pelletier, 2018) ? Que peut-on apprendre des « partis-mouvements » qui cherchent à se positionner comme alternatives aux modèles partisans traditionnels (Della Porta et coll., 2017 ; García Agustín et Briziarelli, 2018 ; Cervera-Marzal, 2021) ? Comment sont repensés le moment des élections, la place des leaderships et les formes de représentation politique ? Quelles sont les expérimentations en cours, les innovations démocratiques émergentes ? Comment le syndicalisme réussit-il à profiter du regain de combativité observé dans plusieurs sociétés pour réellement politiser son action (Yon, 2023) ? Comment faire vivre une gauche combative ? Quels sont les outils mobilisés en dehors des moments électoraux ou durant ceux-ci ?
Axe 3 : Expériences des gauches dans la durée
Ce dernier axe propose de traiter des ajustements et renouvellements (ou non) des partis des gauches sur le temps long ; de la continuité des expériences d’autogestion ; de la pérennité nécessaire (ou non) des alliances pour construire des solidarités locales, nationales ou transnationales. À tous les échelons d’action politique, comment les gauches réussissent-elles à mettre en place des projets pérennes et à changer durablement les conditions de vie imposées par le capitalisme ? La résilience de certaines gauches parlementaires est-elle porteuse de leçons pour l’exercice du pouvoir au niveau national ? Les initiatives locales de communautés autogérées parviennent-elles à modifier durablement les équilibres politiques ? L’échelon municipal est-il à (ré)investir et constitue-t-il un creuset de renouvellement pour les idées et projets de gauche ? Dans quelle mesure les initiatives d’autogestion, de coopération, d’économie solidaire, mises en place par la société civile en dehors des institutions politiques formelles représentent-elles, elles aussi, une forme de réactualisation d’un projet de société de gauche ? Quels potentiels offriraient leur mise en réseau et leur mise à l’échelle ? Dans quels espaces et dans quelles conditions les gauches sont-elles encore capables de dépasser leur fonction de résistance pour exercer concrètement le pouvoir et mettre en place leurs initiatives ?
* * *
Quel que soit l’axe privilégié, les articles attendus reposeront sur les résultats de travaux empiriques en lien avec la thématique du numéro. Ils pourront aussi prendre la forme de contributions aux débats théoriques et méthodologiques.
Les auteur∙ices sont invité∙es à envoyer une proposition de contribution (1 à 2 pages, environ 6 000 signes), en précisant leur affiliation universitaire, avant le 1er décembre 2025, aux responsables du numéro : pascale.dufour@umontreal.ca ; heloise.nez@u-paris.fr ; thomas.collombat@uqo.ca. Celles et ceux dont la proposition aura été retenue par le comité de rédaction seront invité∙es à soumettre un article complet pour le 15 mars 2026. La parution du numéro thématique est prévue pour le printemps 2027.
La revue ne publie que des textes inédits. Les auteur∙ices sont tenu∙es d’aviser la rédaction de tout projet de publication concurrent.
Abraham, Yves-Marie. 2019. Guérir du mal de l’infini. Produire moins, partager plus, décider ensemble. Montréal, Écosociété.
Ancelovici, Marcos, Pascale Dufour et Héloïse Nez. 2016. Street Politics in the Age of Austerity. From the Indignados to Occupy. Amsterdam, Amsterdam University Press.
Çetin, Neslihan. 2023. « États autoritaires et façade démocratique », La vie des idées, 30 mai : https://laviedesidees.fr/Etats-autoritaires-et-facade-democratique.
Cervera-Marzal, Manuel. 2021. Le populisme de gauche. Sociologie de la France insoumise. Paris, La Découverte.
Collombat, Thomas et Xavier Lafrance. 2022. « Recomposition de la gauche québécoise et rôle politique du syndicalisme », Recherches sociographiques, 63, 1-2 : 131-156.
Cossart, Paula et Pierre Sauvêtre. 2020. « Du municipalisme au communalisme », Mouvements, 101, 1 : 142-152.
Della Porta, Donatella et Alice Mattoni. 2014. Spreading Protest. Social Movements in Times of Crisis. Colchester, ECPR Press.
Della Porta, Donatella, Joseba Fernández, Hara Kouki et Lorenzo Mosca. 2017. Movement Parties against Austerity. Cambridge, Polity Press.
Demias-Morrisset, Raphaël. 2024. L’illibéralisme, aboutissement ou lendemain du néolibéralisme ? Thèse de doctorat en science politique, Université de Bordeaux.
Durand, Cédric et Razmig Keucheyan. 2024. Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique. Paris, Zones.
Escobar, Arturo. 2018. Designs for the Pluriverse. Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Durham, Duke University Press.
Foucraut, Elsa. 2023. « Penser le cadrage et le narratif », dans Guide du plaidoyer. Paris, Dunod : 35-43.
Frega, Roberto. 2021. « The fourth stage of social democracy », Theory and Society, 50 : 489-513.
García, Agustín Óscar et Marco Briziarelli. 2018. Podemos and the New Political Cycle. Left-Wing Populism and Anti-Establishment Politics. Londres, Palgrave.
Gaxie, Daniel et Willy Pelletier. 2018. Que faire des partis politiques ?. Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant.
Gorz, André. 2008. Ecologica. Paris, Galilée.
Kouhar, Roman et David Paternotte. 2018. Campagnes anti-genre en Europe. Des mobilisations contre l’égalité. Lyon, Presses universitaires de Lyon.
Kovel, Joel. 2007. The Enemy of Nature. The End of Capitalism or the End of the World? Londres, Zed Books.
Laurin-Lamothe, Audrey, Frédéric Legault et Simon Tremblay-Pepin. 2023. Construire l’économie postcapitaliste. Montréal, Lux.
Lefebvre, Rémi. 2022. Faut-il désespérer de la gauche ? Paris, Textuel.
Liu, Helena, Angela Martinez Dy, Sadhvi Dar et Deborah Brewis. 2021. « Anti-racism in the age of White supremacy and backlash », Equality, Diversity and Inclusion, 40, 2 : 105-113.
Nez, Héloïse. 2022. Démocratie réelle. L’héritage des Indignés espagnols. Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant.
Off, Gefjon. 2023. Contested Feminism: Backlash and the Radical Right. Thèse de doctorat en science politique, University of Gothenburg.
Olin Wright, Erik. 2010. Envisioning Real Utopias. Londres/New York, Verso.
Olin Wright, Erik. 2020. Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle. Paris, La Découverte.
Pontusson, Jonas. 1992. « At the End of the Third Road: Swedish Social Democracy in Crisis », Politics & Society, 20, 3 : 305-332.
Rothstein, Bo et Sven Steinmo. 2013. « Social Democracy in Crisis? What Crisis? », dans Michael Keating et David McCrone (dir.). The Crisis of Social Democracy in Europe. Édimbourg, Edinburgh University Press : 122-146.
Shulz, Sébastien, Héloïse Nez, Clément Petitjean, Julien Talpin et Karel Yon. 2024. « Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle », Mouvements, 117, 2.
Tiberj, Vincent. 2024. La droitisation française. Mythe et réalités. Paris, Presses Universitaires de France.
Verdier, Margot, David Hamou et Pierre Sauvêtre. 2021. « Communalisme/municipalisme : du passé au possible », Terrains Théories, 13.
Yon, Karel. 2023. Le syndicalisme est politique. Questions stratégiques pour un renouveau syndical. Paris, La Dispute.